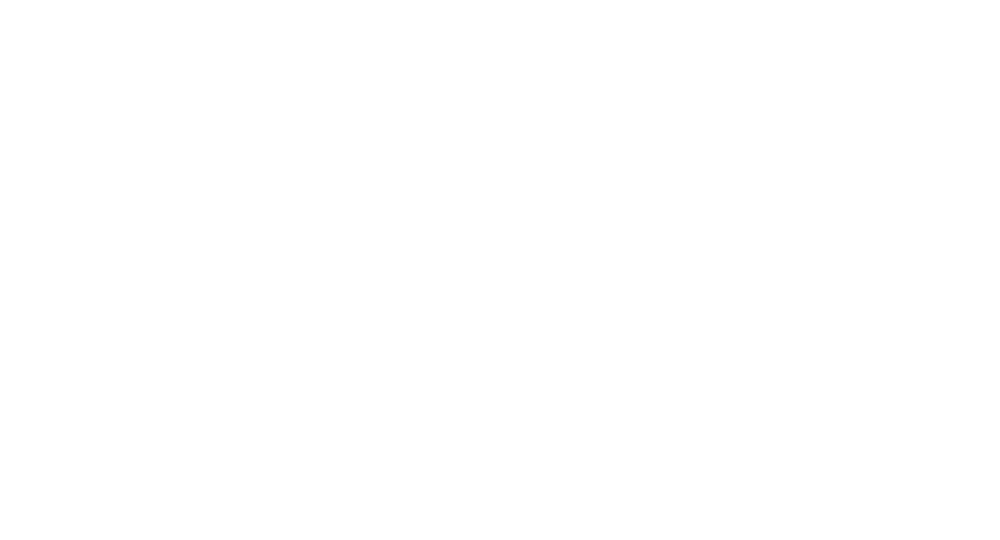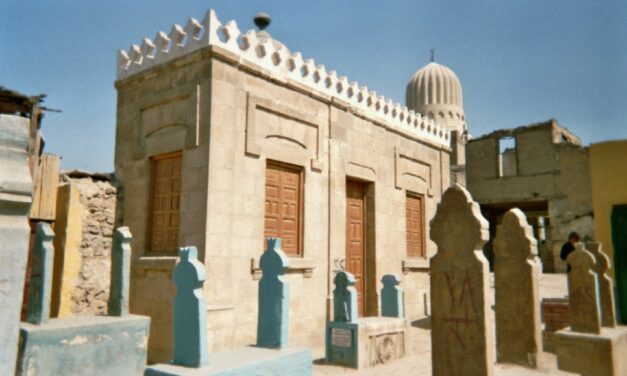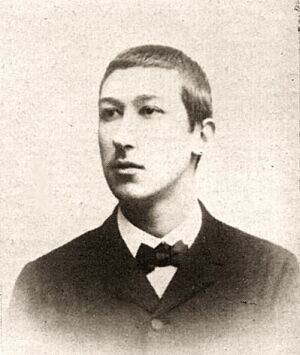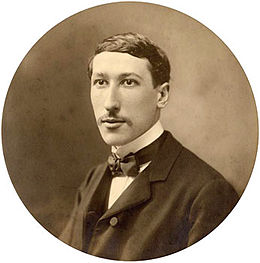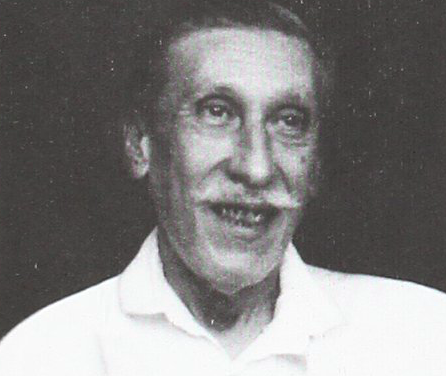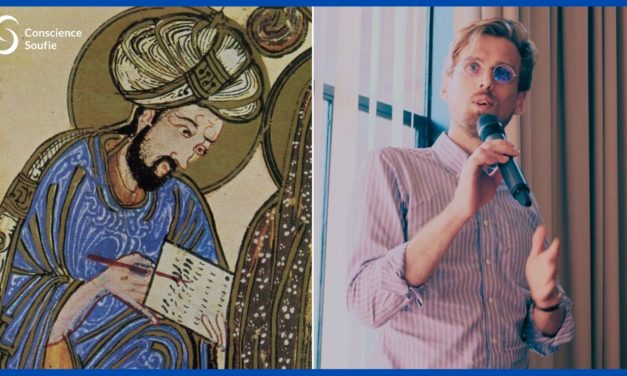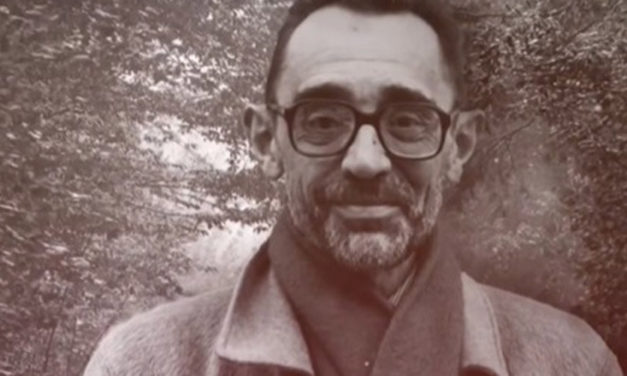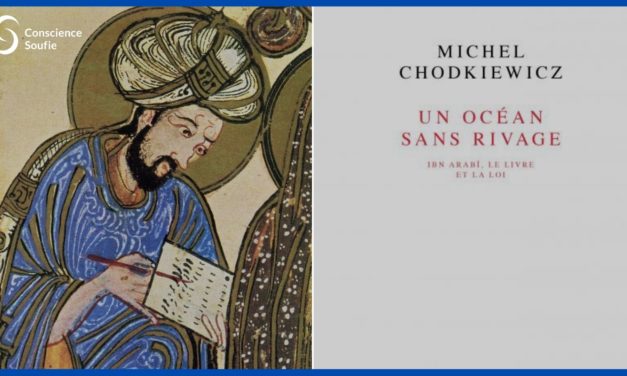Conseils de lecture :
Cycle « Hommage à René Guénon »
Comment aborder l’œuvre de René Guénon, aussi impressionnante par son ampleur – plus d’une vingtaine d’ouvrages, hors correspondance – que diverse par les sujets traités ? Conscience soufie vous propose de vous guider dans cette découverte.