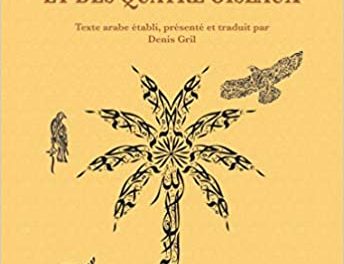Dans toutes les traditions religieuses ou philosophiques qui ont recours à cette fonction, la figure du maître spirituel n’est ni univoque ni intangible. Elle est le fruit d’un processus historique qui, à un moment donné, détermine des caractéristiques qui sont susceptibles d’évoluer, au moins sur le plan formel, si ce n’est sur le fond. Le soufisme ne fait pas exception, lui qui fut une réalité avant d’avoir un nom, selon Qushayrî (m. 1072)1. De la même manière, la maîtrise spirituelle a existé avant d’être nommée ou clairement identifiée comme telle, et ce n’est que vers les 10e et 11e siècles qu’elle fut conceptualisée et exposée dans un corpus doctrinal explicitant ses modalités et sa finalité.
Les références scripturaires
Dans l’islam, l’un des premiers termes qui servit à exprimer un lien entre un maître qui enseigne et le disciple qu’il instruit est formé sur la racine sahiba (ou sâhaba) qui signifie « être le compagnon de » ou « accompagner quelqu’un » et ses formes dérivées, comme sâhib, le compagnon. Le passage coranique relatant l’éphémère rencontre entre Moïse et al-Khidr, personnage énigmatique traversant les âges et doté d’une science qu’il tient directement de Dieu, fait usage de cette racine. Mis à l’épreuve par al-Khidr, Moïse reconnaît son incapacité à respecter les conditions qu’il lui a imposées pour bénéficier de son compagnonnage, à savoir se montrer patient et ne pas l’interroger sur ses actes. Al-Khidr lui laisse une dernière chance, et lui propose : « Si désormais je t’interroge sur quoi que ce soit, ne me garde plus comme compagnon (fa-lâ tusâhib-nî) » (Cor. 18, 76). Cet épisode coranique qui suscita une abondante littérature exégétique représente pour les soufis le modèle archétypique de la relation de maître à disciple.
Une autre occurrence intéressante pour notre sujet est la partie du verset suivant : « Dieu l’assista quand, banni par les dénégateurs, et alors qu’ils se trouvaient à seulement deux dans la grotte, il dit à son compagnon (sâhib) : – Ne sois pas triste ! Dieu est avec nous » (Cor.9, 40). Ce verset fait référence à l’Hégire, la fuite du Prophète de La Mecque à Médine. Quant à celui que le Coran désigne comme ‘son compagnon’, la tradition exégétique l’identifie à Abû Bakr, le premier calife. Ce dernier incarne le modèle parfait du compagnon qui est aussi et surtout un disciple ayant fait don de sa personne et de ses biens pour suivre celui dans lequel il avait une foi absolue. Aussi, dès le 10e siècle, les soufis le reconnurent comme le premier pôle spirituel (qutb) de l’islam, conjoignant en sa personne le pouvoir temporel et l’autorité spirituelle. Deplus, collectivement, tous ceux qui virent le Prophète et crurent en lui sont désignés comment étant les Compagnons (sahâba), terme formé encore sur la même racine. La relation du Prophète, non pas avec tous ses contemporains, mais avec ceux qui furent les plus proches, servit également de référence et de modèle aux soufis dans l’instauration de la relation de maître à disciple.
Le compagnonnage spirituel (suhba)
Si la notion de compagnonnage spirituel (suhba) a bien un fondement scripturaire, il est difficile de savoir exactement le sens à donner à celui-ci pour les premiers siècles de l’islam. A partir du monumental ouvrage d’Abû Nu‘aym al-Isfahânî (m. 1038), la Hilyat al-awliyâ’, essentiel pour appréhender la richesse des expériences spirituelles des quatre premiers siècles de l’islam, Denis Gril a interrogé la signification de cette suhba pour l’une des figures tutélaires du soufisme, Ibrâhîm b. Adham (m. 777-8), que les soufis placent parmi les tout premiers maîtres de la première génération des soufis2. Car la manière dont nous devons comprendre ce verbe employé dans les premiers textes du soufisme ne va pas de soi. Signifie-t-il ‘être le compagnon d’un tel’, ce qui pourrait suggérer une relation d’égalité, ou bien plus nettement ‘être le disciple de’, ce qui sous-entend un lien de subordination ? Toutefois, pour les maîtres du 4e siècle, Denis Gril constate que : « ‘accompagner’ (sahiba) un tel signifie assez clairement se faire son disciple3 ». Ce constat est fait à partir d’un autre ouvrage, lui aussi essentiel pour la connaissance de cette période, qui recense par générations les autorités premières du soufisme, les Tabaqât al-sûfiyya d’Abû ‘Abd al-Rahmân al-Sulamî (m. 1021). Dans cet ouvrage, l’auteur a réuni un ensemble de cent cinq maîtres dont l’exemple et l’enseignement fondent la science du soufisme. C’est le plus souvent en usant de cette racine sahiba que Sulamî décrit les relations que le maître mentionné dans les biographies entretint avec ceux qui l’ont formé spirituellement et auprès desquels il est parvenu à la maîtrise spirituelle. Ce n’est cependant pas la seule modalité permettant de tirer un profit spirituel d’un maître et d’acquérir une autorité. L’auteur en relève d’autres comme le fait de le rencontrer, l’accompagner en voyage, l’interroger ou tout simplement le voir.
Transmission et lignages spirituels
reprochant d’avoir dévoilé ce que sa voie lui imposait de cacher. De manière générale, un disciple reste rarement attaché à un seul maître. Au contraire, les liens de maîtres à disciples sont le plus souvent multiples et ne semblent pas limités par des contraintes liées à des règles de convenances (âdâb) ou des usages particuliers. La suhba avec un maître représente souvent une étape dans un cheminement spirituel. Ainsi Abû ‘Uthmân al-Hîrî (m. 910), grand maître de Nishapur, eut trois maîtres, chacun lui enseignant une station spirituelle, d’après Hujwirî.4 De ce point de vue, le cas le plus emblématique des Tabaqât al-sûfiyya est celui de ‘Alî al-Sayrafî (m. 969-70) pour lequel l’auteur énumère un total de dix-sept maîtres dans beaucoup de lieux différents. Cependant, nous pouvons déduire de la présentation des notices que ce compagnonnage avec un ou plusieurs maîtres paraît être le premier garant de l’autorité du futur maître, ce qui lui permet à son tour de prendre en charge des disciples en tant que maître, après avoir bénéficié, par cette suhba, de l’exemple et de l’enseignement de celui avec qui il l’a pratiquée.
Dans le texte d’al-Sulamî la question de la transmission de la maîtrise spirituelle est une autre préoccupation de l’auteur. Par exemple, il est dit de Shaqîq al-Balkhî (m. 810) : « Il fut le maître (ustâdh) de Hâtim al-Asamm et le compagnon/disciple d’Ibrâhîm b. Adham et de lui il prit la voie (akhadha ‘anhu l-tarîqa)5». Ici, et dans d’autres exemples que l’on peut aisément tirer de l’ouvrage, se dessine plus nettement une filiation, prémices des lignages spirituels, les silsila-s qui apparaissent de manière plus précise, à partir du Kashf al-Mahjûb de Hujwirî qui recense dix confréries orthodoxes, chacune étant rattachée à son fondateur6.
Émergence de la figure du maître
C’est autour des 10e et 11e siècles que le soufisme, après la phase initiale du siècle précédent, connaît des transformations importantes. À l’Occident du monde musulman, Ibn ‘Abbâd de Ronda datait du 11e siècle le passage du shaykh al-ta‘lîm, du maître qui dispense un savoir au shaykh al-tarbiya, le maître qui éduque et initie7. Le changement, qui s’est sans doute opéré progressivement, réside dans la formulation de cette relation qui, détaillée et codifiée, devient en elle-même modalité privilégiée de la progression spirituelle. Elle n’est pas nouvelle mais fonctionnait auparavant de façon plus informelle dans le cadre souple de la suhba, compagnonnage spirituel qui continue de lier le disciple au maître et restera même plus tardivement pour Ibn ‘Arabî l’élément fondamental de la relation initiatique. Mais elle est maintenant codifiée et doctrinalement justifiée et exposée. Le maître ne dispense pas seulement un savoir, il est devenu une présence transformante.
C’est en effet à cette époque (celle qui va de Sulamî à Qushayrî ou Hujwirî), qu’en moins d’un siècle, l’argumentation s’affine pour expliquer et justifier la nécessité impérieuse d’un maître et poser les premières règles régissant la relation de maître à disciple. Elles reposent d’après Sulamî sur le Coran, la sunna et le modèle de la communauté primitive autour du Prophète. Le compagnonnage spirituel perpétue les liens entre le Prophète et les Compagnons. Les règles des bons usages (âdâb) véhiculées par les maîtres sont celles du Prophète et le respect que lui doivent les disciples découle de la vénération que les Compagnons lui portaient et que le Coran leur avait imposée. Les maîtres et leurs disciples reproduisent et perpétuent le modèle idéal incarné par la jeune communauté musulmane autour de Muhammad, source de méditation inépuisable.
Les premiers ascètes, voués à l’amour exclusif de Dieu, n’avaient nul besoin de recourir à une quelconque médiation. Ainsi Ja‘far al-Sâdiq (m. 765) n’admet aucun intermédiaire ni la moindre diversion quand il affirme : « La voie spirituelle (tarîq) va du coeur à Dieu, en se détournant de tout ce qui est autre que Lui8 ». Avec l’émergence de la figure du maître s’affirme également la référence constante au Prophète comme seul et unique modèle qui envahit l’espace de la vie spirituelle. Comme le Prophète, le maître inspire la vénération, et, signes d’une confiance absolue dans la nature de sa fonction, une obéissance sans réserve et une adhésion totale à tout ce qui émane de sa personne. Ce sont les conditions à remplir pour que s’opère l’alchimie de la mujâlasa (la fréquentation d’un maître dans son intimité, en partie synonyme de la suhba), cette action imperceptible par laquelle le maître transforme les défauts du disciple en qualités, et le fait s’élever vers la perfection humaine qui lui permettra d’approcher la présence divine.
Vivre dans la proximité immédiate d’un maître est assurément l’un des moyens les plus efficaces pour acquérir une éducation spirituelle permettant de progresser dans la Voie. À travers les siècles, les maîtres se sont montrés unanimes sur ce point, les manuels de soufisme en attestent. Cependant le compagnonnage n’est pas le seul moyen d’accéder à la voie des soufis. Certaines pratiques ou une orientation spirituelle particulière constituaient pour les premiers soufis une voie en soi. Junayd (m. 911), le grand maître de Bagdad, parlait ainsi de ‘la voie des oeuvres’ et Ibrâhim al-Khawwâs (m. 903-4) suivait ‘la voie de l’abandon confiant à Dieu’9. Plus tardivement apparurent des maîtres qui s’affranchirent, au moins en partie, de la tutelle d’un maître représentant d’une confrérie. Ainsi, ‘Abd al-‘Azîz al-Dabbâgh (m. 1719), considéré comme un saint « illettré », fut initié directement par al-Khidr et Ahmad Tijânî (m. 1815) par le Prophète en personne.
Dans le monde moderne, se pose pour les aspirants au soufisme cette question : peut-on se passer de la suhba d’un maître, devenue de plus en plus difficile à pratiquer, et surtout par quoi la remplacer ? S’il n’est pas aisé de répondre à cette question, l’histoire du soufisme nous invite à penser qu’il n’y a pas une seule réponse possible et que chacun peut en trouver une correspondant à sa situation, à ses exigences et au degré de son aspiration.
Jean-Jacques Thibon est professeur à l’Inalco (Paris) où il enseigne l’islamologie. Il est spécialiste du soufisme à l’époque médiévale et a publié de nombreux articles sur les débuts du soufisme et des traductions dont Les générations des soufis de Abû ‘Abd al-Rahmân al-Sulamî (m. 1021), Brill, 2019.