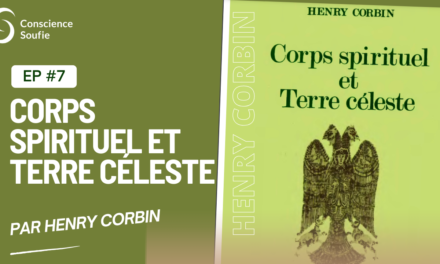IBN ‘ARABÎ DANS L’ŒUVRE DE HENRY CORBIN
Rien n’est plus instructif que de lire l’une après l’autre, dans un ouvrage récent sur Ibn ‘Arabi, deux citations intentionnellement juxtaposées par l’auteur. La première est de Massignon. Elle dénonce le « monisme syncrétique » de l’auteur des Fusü9 et, dans un de ces singuliers mouvements oratoires si fréquents chez Massignon, oppose « ceux qui se prosternent le long de la Via Crucis et ceux qui s’étendent sous le char de Jaggernauth». Si l’allusion au chemin de croix, sans être pertinente, ne surprend qu’à demi sous la plume de ce converti effervescent, la référence à un avatar de Vishnou laisse carrément perplexe. La seconde citation est d’Henry Corbin. Bien que Massignon n’y soit pas nommé, il est évident qu’elle est une réplique frontale à ses fatwas anti-akbariennes. « On a parfois, écrit Corbin, prononcé le mot de syncrétisme. C’est l’explication sournoise et paresseuse de l’esprit dogmatique. Se contenter d’une pareille explication, c’est avouer son propre échec » l .
Ces deux textes ont seulement valeur d’échantillons : on en recenserait sans peine beaucoup d’autres de la même encre chez leurs auteurs respectifs. Mais leur face-à-face me paraît illustrer de manière très adéquate le problème que posait, il y a une quarantaine d’années, le statut académique d’Ibn ‘Arabi et la contribution décisive d’Henry Corbin à une évolution positive de ce statut. « La bibliographie concernant Ibn ‘Arabï, aussi bien en langue française que dans nos langues européennes, peut tenir en quelques lignes » déclarait Corbin en 1958 2. De fait, les seuls travaux universitaires importants publiés à l’époque étaient dus à des chercheurs que l’on pouvait compter sur les doigts d’une main et dont aucun n’était français • Nyberg, Nicholson, Asin Palacios et Afifi. Encore faut-il noter que, pour Nyberg et Nicholson, Ibn ‘Arabi était un centre d’intérêt parmi beaucoup d’autres. L’apport d’Asin Palacios fut, lui, décisif et, malgré les fortes critiques que m’inspirent certaines de ses interprétations, je tiens à souligner qu’il serait très injuste d’oublier ce qu’on lui doit. La formation d’un ecclésiastique espagnol à la fin du XIxe siècle ne semblait pourtant pas a priori la meilleure préparation à une étude pénétrante des écrits du Shaykh al-Akbar. Mais la fréquentation des mystiques du Siècle d’or, c’est à dire d’une littérature qui n’intéressait guère le très positiviste orientalisme des débuts du siècle, l’a certainement aidé à comprendre la pensée du maître andalou et le type d’expérience spirituelle auquel elle renvoyait.
Ses convictions de prêtre catholique ne sont certes pas sans influence sur sa lecture des textes. Ses traductions christianisent parfois abusivement le vocabulaire et, par là-même, la doctrine d’Ibn ‘Arabi. On sait d’autre part qu’Asin avait imaginé un ingénieux système de vases communicants : le soufisme, selon lui, s’était à l’origine approprié une part de l’héritage des contemplatifs chrétiens mais avait fini par la restituer à ses propriétaires, non seulement en fournissant à la Divine Comédie un vaste répertoire de symboles mais en marquant de son empreinte l’école carmélitaine et les alumbrados. Une révision sévère de ces constructions hypothétiques s’imposait évidemment. Reste que l’on doit reconnaître à Asin le mérite d’avoir révélé des richesses insoupçonnées, grâce, notamment, à son exploration systématique des Futülpât; et qu’au total il a, me semble-t-il, pénétré beaucoup plus profondément la pensée du Shaykh al-Akbar que le musulman Afifi . Pour ce dernier la « philosophie mystique » d’Ibn ‘Arabi relève essentiellement d’un néoplatonisme abâtardi dont le recours à des citations scripturaires détournées de leur sens ne saurait masquer la nature. Du moins Afifi, à qui l’on est redevable de la première édition critique des Fusüs, a-t-il lu attentivement l’œuvre d’Ibn ‘Arabi. L’analyse qu’il en donne est, à mes yeux, très réductrice mais, lorsque sa thèse fut publiée, elle présentait l’avantage de tracer au cordeau quelques routes dans l’épais massif akbarien.
Quant à la France, si Ibn ‘Arabï n’y était pas complètement ignoré, il le devait à des travaux conduits en dehors du cadre universitaire — et d’ailleurs par des hommes dont aucun n’était français : le suisse Titus Burckhardt qui, en 1955, publiait une traduction française partielle des Fusüs et le roumain Michel Vâlsan qui, lui, traduisait quelques courts traités et surtout une série de chapitres des Futühât. Comment expliquer l’étonnant silence des islamologues ? Les dimensions énormes du corpus akbarien, l’obscurité de son langage, l’absence presque totale d’éditions critiques (ou d’éditions tout court) étaient-ils de nature à décourager les valeureux chercheurs qui s’engageaient dans la patiente préparation d’un doctorat d’état ? Ces arguments ont pu peser mais je ne les crois pas décisifs : on a vu des carrières de spécialistes se jouer sur des paris qui n’étaient guère moins risqués. De surcroît, les publications de scholars étrangers apportaient déjà de solides repères. Le rôle négatif de Massignon, maître alors incontesté des études sur la mystique musulmane, me paraît en revanche avoir été déterminant et c’est donc sa propre attitude qui réclame une explication : pourquoi, à l’égard d’Ibn ‘Arabi et de ses disciples, un tel parti pris de dénigrement ? Cette hostilité véhémente, persévérante, obsessionnelle apparaît dès les premiers écrits de Massignon et persistera jusqu’à la fin. Les confidences de quelques jeunes chercheurs qui avaient eu l’imprudence d’exprimer devant lui un intérêt sans apriori pour l’œuvre d’Ibn ‘Arabi témoignent qu’en privé Massignon pouvait être plus violent encore. Ibn ‘Arabi n’était pas pour lui un auteur dont on peut, méthodiquement mais sans passion, discuter le style ou les idées : c’était une sorte d’adversaire personnel. À cet étrange comportement on distingue sans peine une première cause : Ibn ‘Arabi, s’il parle souvent de Hallâj comme d’un saint éminent, ne se prive pas néanmoins de lui reprocher certaines imperfections et donc d’affirmer à diverses reprises, par rapport à lui une position d’autorité comme l’atteste, entre autres, un singulier dialogue du Kitâb al-Tajalliyyât6 relatif à la mort de Hallâj. Aux yeux de Massignon, cette attitude est impardonnable et il n’a pas de mots assez durs pour critiquer « le style autoritaire et compassé», le «ton impassible et glacé» des jugements d’Ibn ‘Arabï ». Mais, plus profondément, l’opposition radicale de Massignon au Shaykh al-Akbar a sa source dans sa conception des critères qui authentifient une voie mystique et la distinguent de ses imitations ou de ses contrefaçons. Selon cette conception, qui est celle de la théologie mystique de l’époque, avec un accent caractéristique sur la spiritualité victimale », Ibn ‘Arabi apparaît comme un orgueilleux gnostique « épris de logique formelle », qui élimine « toute intervention transcendante de la divinité : un nouveau Pélage, dont Massignon se veut l’Augustin. L’impérieux magistère que ce dernier exerçait dans l’islamologie française ne pouvait, dans ces conditions, que freiner toute velléité d’entreprendre des recherches de longue haleine sur Ibn ‘Arabi. La place de ce dernier dans les ouvrages relatifs au soufisme fut longtemps systématiquement reléguée au chapitre réservé à la description des « siècles de décadence ».
Et puis il y eut Corbin. Dès ses débuts d’orientaliste, ce dernier avait marqué son intérêt pour des personnages réputés marginaux : Suhrawardi et Ibn Sab’ïn. Un parcours ainsi commencé le conduisait inévitablement à la rencontre d’Ibn ‘Arabï. Conférences, articles, séminaires préparèrent les voies du livre qui parut enfin en 1958 sous le titre L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn Arabî. Une forte sympathie, au sens plein du terme, s’y affirmait dès les premières pages.
La sympathie ne garantit pas toujours la clairvoyance. Elle peut reposer sur un malentendu. Or ce qui, surtout, faisait de cet ouvrage une étape décisive dans l’histoire des études akbariennes, c’était le souci qu’avait Corbin de comprendre la pensée d’Ibn Arabi dans ses propres termes. Ecartant la condescendante distinction néo-scolastique entre « mystique surnaturelle » et « mystique naturelle», il s’appliquait à saisir la cohérence de la doctrine sous l’apparent désordre de ses énoncés. S’avançant dans la forêt des symboles, il refusait de ne voir en eux que les arbres secs de métaphores arbitraires mais les montrait fondés — en fait, dans l’expérience visionnaire et en droit dans la doctrine du ‘âlam al-khayâl, du (monde imaginal ». D’autres, avant lui, avaient bien sûr signalé la notion de khayâl comme un des constituants de la cosmologie akbarienne. Aucun n’avait, comme Corbin, établi l’importance de sa double fonction médiatrice dans la hiérarchie des degrés de l’existence universelle et dans la géographie du voyage initiatique.
De même aussi insistait-il avec raison sur le rôle de la dialectique d’amour » dans la doctrine d’Ibn ‘Arabi. tous les maîtres du soufisme, écrivait-il, Ibn ‘Arabi est, avec Rüzbehân de Shiraz, l’un de ceux qui ont poussé le plus loin l’analyse des phénomènes de l’amour ». Cette appréciation de celui qui s’était voulu 1’« interprète des désirs » n’allait pourtant pas de soi. Il était naguère habituel d’opposer, dans la spiritualité rhéno-flamande, Minnemystik (orthodoxe) et Wesenmystik (suspecte de panthéisme). Ce schéma réducteur avait son équivalent dans l’irréductible incompatibilité que Massignon croyait voir entre un Hallâj « amoureux de Dieu » et l’auteur des Fusüs dont le « vocabulaire théorique subtil, visant des hiérarchies gnostiques incontrôlables» est réservé à des «corporations intellectuelles fossiles . . . fumeries d’opium surnaturel
Selon Ibn ‘Arabi, le ‘ârifkâmil reconnaît Dieu sous les multiples formes que lui assignent les créatures et, sans être prisonnier d’aucune d’elles, les valide toutes car il perçoit leur fondement in divinis (mustanad ilâh). Ce thème du haqq almakhlüq fil-i’tiqâdât est pour Corbin l’occasion d’exposer la doctrine des théophanies dont il est inséparable dans la pensée du Shaykh Muhyi I-dïn et de démontrer l’inanité des accusations de syncrétisme. Sur ce sujet, toutefois, un anti-dogmatisme très sensible dans beaucoup de ses travaux me paraît conduire Corbin à faire dire à Ibn ‘Arabï plus qu’il ne dit — en déclarant, notamment, que ce dernier est « étranger à la religion de la lettre et du dogme » . Cette remarque m’amène à émettre une première réserve sur les interprétations qu’il propose : s’il nous offre souvent des analyses pénétrantes, s’il a très efficacement contribué par là à donner un élan à de nouvelles recherches — auxquelles son crédit personnel conférait opportunément une légitimité académique — Corbin est sans doute aussi responsable, me semble-t-il, d’erreurs de perspective qui n’ont pas été sans conséquences sur des lectures ultérieures de l’œuvre akbarienne.
L’enseignement d’Ibn ‘Arabi se nourrit du Coran : il y trouve son inspiration, son langage et jusqu’à sa structure formelle. Le Shaykh al-Akbar l’affirme à maintes reprises et une lecture attentive vérifie cette affirmation à un degré de précision insoupçonnée de la plupart des spécialistes occidentaux. . . mais aussi de scholars musulmans comme Afifi. Corbin, bien sûr, n’ignore pas les références coraniques qui fourmillent dans les Fusüs ou les Futühât et ne commet pas le contresens d’y voir une simple précaution propre à déjouer la vigilance de fuqahâ soupçonneux. Mais il n’a pas perçu la force de cette relation qu’on peut dire génétique entre la Révélation coranique et les textes qu’il étudie. Une clef de déchiffrement fondamentale, car elle seule permet d’élucider des formulations énigmatiques et de découvrir la logique d’une architecture déconcertante, lui a donc fait défaut. Sans m’étendre sur un problème que j’ai traité ailleurs 1 4, je me bornerai à mentionner ici un exemple caractéristique des insuffisances d’une interprétation dépourvue de cette clef.
Comme Afifi avant lui, Corbin a relevé dans le chapitre 272 des Futühat un passage sur l’unitude divine (al-ahadiyya) où celle-ci est représentée symboliquement comme un édifice (bayt, que Corbin traduit par «temple») impénétrable qui comporte cinq piliers dont l’un est accolé à l’édifice mais saille à l’extérieur. Ce cinquième pilier, déclare Ibn ‘Arabï, bien qu’il fasse partie de cette «demeure spirituelle» (manzil) ne lui est pas propre mais se trouve dans tous les manâzil. Ni Corbin, ni Afifi, ni Asin Palacios qui, lui aussi, avait signalé ce texte ne donnent d’explication du nombre de ces piliers ou du fait que le cinquième est «à l’extérieur» et n’appartient pas exclusivement à ce manzil. Aucun d’eux ne se risque non plus à commenter l’affirmation selon laquelle certains des «hommes du dévoilement» déclarent que l’édifice repose sur six piliers sans que ce désaccord apparent les mette en contradiction avec ceux qui n’en voient que cinq. La mention sybilline, quelques lignes plus loin, du «deuxième dinar» par lequel on accède à ce manzil et du «quatrième dinar qui en est le terme est également passée sous silence.
Or ce chapitre 272 (dans lequel Asin discerne aventureusement un concept de l’Un « littéralement plotinien ») fait partie du fasl al-manâzil des Futühât, c’est-à-dire d’une section dont les 114 chapitres sont chacun en correspondance avec une des 114 sourates du Coran dont ils constituent une exégèse ésotérique. Que le mot manzil soit, pour lui, synonyme de « sourate », Ibn ‘Arabi le précise maintes fois et l’on s’étonne que cette indication, comme aussi le nombre même des manâzil, n’ait pas retenu l’attention. Il est vrai que la relation entre chaque manzil, ou chapitre, avec une sourate n’apparaît pas au premier regard car il semble d’abord aller de soi de la vérifier en suivant l’ordre des sourates dans le mushaf ce mode de lecture se révèle vite infructueux. D’autres passages des Futühât ou d’autres œuvres (en particulier le Manzil al-manâzil) permettent de corriger cette erreur : les manâzil doivent être envisagés su’üdan, , en « remontant » de la dernière sourate à la première. Les correspondances entre chapitres et sourates deviennent dès lors évidentes et l’on constate que, dans cet ordre inverse, le chapitre 272 est consacré à la sourate al-ikhlâs (s. 112) — d’où son titre: « manzil de la transcendance de l’unitude» (tanzïh al-tawhîd).
C’est donc en se référant à cette sourate que la description du bayt prend tout son sens : les quatre piliers internes sont les quatre versets d’al-ikhlâs, le cinquième — celui qui saille à l’extérieur — étant la basmala, qui n’est pas exclusivement propre à cette sourate puisqu’elle figure en tête de toutes les autres. Et si certains parlent plutôt de six piliers c’est que, comme le signale Suyütï, il existe des recensions qui dénombrent cinq versets (par dédoublement du verset 3 : Lam yalid/wa lam yülad) sans que cela affecte le texte de la sourate.
La basmala, qui est le « couronnement des sourates » (tatwïj al-suwar) est l’expression de la Miséricorde divine, laquelle est l’interprète (turjumân), le médiateur sans lequel le secret du manzil serait radicalement inaccessible à la créature . Ce cinquième (ou sixième) pilier n’étant que partiellement extérieur au temple clos de l’Unitude, la communication ne s’établit toutefois que par une seule de ses faces (wajh wâlgid), celle qui est tournée vers nous. Cette face unique quiconque est familier avec le code du langage akbarien, qui renvoie inlassablement à la lettre de l’Ecriture, comprend qu’elle n’est autre que le dernier mot, le terme de la basmala : rallïm, le «très Miséricordieux». Mais ce n’est pas tout : les diverses occurrences dans le Coran d’un même vocable dessinent un réseau discret d’harmoniques auquel, comme Ibn ‘Arabi lui-même, son lecteur doit être attentif. Corbin, à qui échappent les références coraniques dont ce passage est tissé, a deviné cependant que la question essentielle était de savoir qui est cette « colonne si éloquente » . Or c’est précisément le mot ralpïm qui donne la réponse car, attribut divin, il s’applique aussi à l’Envoyé (Cor. 9:128). Ce que le Prophète historique est dans le monde sensible « langue de vérité » — la baqïqa mullammadiyya métahistorique l’est dans le « monde du dévoilement» (‘âlam al-kashf). Quant aux «dinars» associés à ce manzil, ils sont des désignations symboliques des lettres de l’alphabet. Le deuxième dinar» représente la lettre bâ, initiale de la basmala, dont la valeur numérique est 2 et le « quatrième » la lettre mîm, finale de rahïm, dont la valeur réduite (en faisant abstraction de l’ordre des dizaines) est 4.
C’est donc du Coran que l’énigmatique vision du temple tire sa substance et sa forme. Or cette grille de lecture s’applique sans exception à tous les termes, à toutes les images de ce chapitre et en révèle la cohérence. Sans entreprendre de le démontrer plus avant, je crois nécessaire d’insister sur ce que cet exemple met en évidence : à savoir que l’œuvre d’Ibn ‘Arabi ne peut être parfaitement comprise si on la délie de son contexte coranique d’une part et si, d’autre part, on perd de vue la place centrale qu’y occupe la double fonction du Prophète, dans l’ordre de la nubuwwa et dans celui de la walâya. Ou, pour le dire autrement, si l’on oublie qu’Ibn ‘Arabi est un maître spirituel musulman.
Que penser alors de l’insistance avec laquelle Corbin affirme l’incompatibilité de la religion mystique » dont le Shaykh al-Akbar est un représentant éminent et la « religion légalitaire »? Elle est explicable si l’on entend (« religion légalitaire » dans un sens restrictif, en visant par là les formes abusives ou déviantes du magistère des fuqahâ. Ibn ‘Arabï ne se prive pas de dénoncer les excès de zèle de ces docteurs et de fustiger leurs complaisances pour les puissants. Mais on doit se souvenir aussi qu’Ibn ‘Arabï porte une condamnation sans réserve contre les bâ’iniyya selon lesquels le frifserait exempt de l’observance de la Loi, les prescriptions de cette dernière n’ayant plus pour lui qu’une signification allégorique. parfaite félicité », écrit-il, « n’appartient qu’à ceux qui conjuguent le zâhiret le bâtîn.
Entre bien d’autres textes et, notamment, ceux où il commente longuement, point par point, toutes les règles rituelles relatives à l’ablution, à la prière, au jeûne, etc., il est fort instructif de méditer les chapitres 262 et 263 des Futühât qui traitent respectivement de la sharî‘a et de la haqîqa et affirment leur identité . « Le tasawwuf», dit-il en citant un maître de la génération précédente, c’est les cinq prières et l’attente de la mort ». L’islam d’ Ibn ‘Arabi est un islam intégral, où la Loi et la Voie sont inséparables.
C’est aussi très clairement un islam sunnite. Cela ne résulte pas seulement du contenu des trois professions de foi ( ‘aqâ’id) qui figurent au début des Futühât ou les passages qui, par exemple, soulignent le statut spirituel éminent d’Abû Bakr mais des critiques sévères et répétées des imâmiyya ou des rawâfid. Fort significativement, le chapitre consacré aux khawâtir shaytâniyya attribue à des suggestions diaboliques l’amour excessif des ahl al-bayt qui conduit les shï’ites à insulter les Compagnons et même à calomnier le Prophète : l’habileté du Shaytân consiste en ce cas à proposer au départ des actes en eux-mêmes vertueux — car l’amour des ahl al-bayt est un devoir pour tout musulman — puis à égarer ses victimes en les poussant de proche en proche à la démesure et à la transgression. Là où les ahl al-sunna sont majoritaires, précise ailleurs Ibn ‘Arabï, l’hérésie s’avance masquée sous les dehors de l’orthodoxie. Mais ces subterfuges sont percés à jour par les awliyâ et, plus spécialement, par certains d’entre eux, les rajabiyyün qui, lorsque des rawâfid sont présents, les voient sous la forme de porcs ou de chiens.
Je pourrais multiplier les références à des énoncés qui excluent tout doute sur la position d’Ibn ‘Arabï . L’obstination avec laquelle Henry Corbin fait de l’auteur des Fusüs un shi’ite honteux ne laisse donc pas de m’étonner. « Certains chapitres du grand livre des Futühât pourraient avoir été écrits par un pur shiite déclaret-il. Ou encore : « les gnostiques shiites ont retrouvé leur propre bien chez Ibn ‘Arabî car sa doctrine est « une imâmologie qui n’ose pas dire son nom ». Il est vrai que, pour Corbin, qui invoque à ce sujet le témoignage de Haydar Âmolï, Dâwüd Qaysarï porterait une lourde responsabilité dans « l’ambiguité qui pèse sur la doctrine d’Ibn ‘Arabi concernant le double sceau de la Walâyat». On peut noter à ce sujet que Qaysari, s’il est effectivement critiqué par Amolï (qui lui reproche un sunnisme ostentatoire et un fanatisme aveugle) ne s’attire pas « toute sa sévérité » : dans une de ses œuvres, Amoli qualifie de kalâm basan une longue citation de Qaysar . Quoi qu’il en soit, Dâwüd Qaysarï est un interprète fidèle et scrupuleux et n’a en aucun cas aggravé la « faute» supposée d’Ibn ‘Arabï: les opinions qu’il attribue à ce dernier sont bien (et souvent littéralement) les siennes. On a donc souvent le sentiment que Corbin reprend à son compte, sans les soumettre aux vérifications nécessaires dans les œuvres du Shaykh al-Akbar, les points de vue et les affirmations d’auteurs shï’ites. C’est ainsi qu’il écrit, en se basant apparemment sur une phrase du Jâmi’ al-asrâr, que « c’est seulement en songe qu’Ibn ‘Arabi s’est vu investi de cette qualité » (de Sceau de la Sainteté muhammadienne). Il est probable qu’il interprète ce propos comme une allusion à un passage célèbre des Fusüs celui du « songe des deux briques » dont l’une est d’or et l’autre d’argent. Ce faisant il néglige des dizaines d’autres texte qui imposent de corriger l’interprétation d’Âmôli. Libre à l’historien de refuser toute crédibilité aux déclarations d’ Ibn ‘Arabï sur son statut de Khatm al-walâya. Mais il ne peut se dispenser de les enregistrer.
Bien d’autres pages témoignent d’un biais analogue. Ibn ‘Arabï, selon Corbin, « commence (à Tunis) à étudier un ouvrage de théologie mystique d’une importance exceptionnelle : le Khal ‘ al-na ‘layn» dont l’auteur, Ibn Qasi, était l’initiateur d’un mouvement « d’inspiration shiite ismaélienne ». Les lignes suivantes montrent que Corbin n’a pas lui-même examiné cet ouvrage ; et il n’a certainement pas lu non plus le commentaire qu’en a fait Ibn ‘Arabi : ce dernier, d’abord intéressé par Ibn Qasi, ne cache pas sa déception au fur et à mesure qu’il avance dans sa lecture et finit par déclarer qu’Ibn Qasi (dont les idées, d’ailleurs, ne me paraissent nullement démontrer une influence ismaélienne) est un « ignorant » (jâhil) . Le désir d’établir une relation entre Ibn ‘Arabi et le shï’isme peut aussi conduire inconsciemment à une lecture fautive des textes : je ne vois pas d’autre explication à la traduction que donne Corbin du prologue des Fusüs en datant la vision du Prophète que rapporte Ibn ‘Arabi du « dixième jour de Moharram », anniversaire de Karbalâ, alors qu’Ibn ‘Arabï déclare expressément qu’elle est survenue pendant la dernière décade de ce mois.
Il est certes très évident qu’entre sunnisme et shï’isme, les frontières furent longtemps poreuses. Tasawwufet ‘irfàn, en dépit des fractures historiques qui brisèrent le patrimoine dont ils étaient les héritiers indivis, ne sont pas étrangers l’un à l’autre. Mais cela ne suffit pas pour faire d’Ibn ‘Arabî un crypto-shï’ite — pas plus que cela ne justifierait de faire d’ÂmoIi ou de Mollâ Sadrâ des crypto-sunnites, malgré la dette qu’ils ont contractée envers Ibn ‘Arabï (et qu’Âmoli, pour sa part, reconnaît explicitement) . Il me semble donc très nécessaire que les recherches futures sur l’œuvre du Shaykh al-akbar se libèrent d’un a priori qui ne peut qu’en fausser la compréhension et se gardent d’imputer à Ibn ‘Arabi des reniements ou des trahisons à l’égard de doctrines qui ne sont pas les siennes.
Il est enfin un troisième aspect des interprétations d’Henry Corbin qui me paraît appeler des réserves. L’importance de la notion de ‘alam al-khayâl a été, je l’ai dit, fort opportunément soulignée par lui et le titre même de son grand ouvrage sur l’imagination créatrice » est, de ce point de vue, très significatif. L’accent ainsi placé sur ce thème akbarien est pleinement justifié. Il convient cependant de mettre le « monde imaginal » à sa place, qui n’est pas la première, et de ne pas en faire la limite infranchissable d’un voyage initiatique. Or on relève sous la plume de Corbin nombre de formules qu’on doit, à tout le moins, taxer d’imprudentes. Affirmer «la validité noétique de l’Imagination active » est une chose. Parler de « la fonction irrémissible de celle-ci puisqu’elle n’est absente d’aucune station mystique » en est une autre . « Ce qu’atteint un être au sommet de son expérience mystique», déclare aussi Corbin, « ce n’est pas, ce ne peut être le fond de l’Essence divine en son unité indifférenciée » car « au terme ultime ce sera une vision de la Forme de Dieu ». Et encore : « à ce degré même (celui de l’Unitude divine absolue, abadiyya) ( . . . ) se manifeste dans l’acte de l’illumination de l’âme du mystique quelque chose qui est pourvu d’une forme et d’une figure ». Ces assertions catégoriques sont démenties par des textes nombreux dont Corbin n’a pas tenu compte et qui interdisent de considérer la perception des haqâ’iq sous les formes qu’elles revêtent dans le monde imaginal comme le point extrême de l’itinerarium in Deum.
Un argument scripturaire, apparemment péremptoire, semble confirmer les conclusions de Corbin : c’est le Lan tarâni, « Tu ne Me verras pas ! » que Dieu oppose à la requête de Moïse (Cor. 7: 143) et qui fait écho à la solennelle affirmation biblique : « Tu ne peux voir Ma Face car l’homme ne peut Me voir et vivre » (Ex. 33, 1 8, 23). Un autre verset coranique peut également être invoqué : « Les regards ne L’atteignent pas mais c’est Lui qui atteint les regards » (Cor. 6:103). Sans évoquer ici les débats des exégètes et des théologiens musulmans sur le problème de la vision de Dieu en relation avec ces données scripturaires, je m’en tiendrai à ce que dit Ibn ‘Arabï lui-même.
Le chapitre 367 des Futühât comporte un long récit de 1’« ascension » (mi‘râj) du Shaykh al-Akbar. La visite de chacun des sept cieux y est l’occasion d’une rencontre avec les prophètes qui y résident. Au sixième ciel s’engage un dialogue avec Moïse : « Tu as demandé à Le voir. Or l’Envoyé de Dieu a dit : nul ne verra Dieu avant qu’il ne meure ! » — en est bien ainsi », répond Moïse. — « Lorsque je demandai à Le voir, Il m’exauça et je tombai foudroyé. Et c’est dans mon foudroiement que je Le vis. » — « Etais-tu donc mort ?» <<J’étais mort, en effet » . De ce dialogue, le Kitâb al-Tajilliyâttire la conséquence en adressant au sâlik cette injonction: « Réclame la vision et ne crains pas d’être foudroyé ! » . « Dieu a des serviteurs auxquels Il a accordé de Le voir dès cette vie sans attendre la vie future » dit aussi Ibn ‘Arabi dans un passage qui se réfère au verset 6: 103 (« Les regards ne L’atteignent pas»): ce qui fait obstacle à la vision, c’est le pluriel (ab9âr), car la multiplicité ne peut jamais saisir l’Un. Cette multiplicité est inhérente à la créature et ne disparaît que pour ceux qui acceptent le foudroiement, qui obéissent à l’exhortation prophétique : « Mourez avant de mourir ».
Il ne s’agit plus ici des théophanies formelles dont le filam al-khayâl est le théâtre et qui sont compatibles avec la subsistance (baqâ) de la créature. L’accès à ce mode de connaissance icônique est certes une étape de la réalisation spirituelle. Ce n’est pas sans raison que l’œuvre d’Ibn ‘Arabi accorde une large place à la description de ses propres visions ou de celles dont furent gratifiés d’autres saints personnages — à commencer par le Prophète lui-même qui déclare J’ai vu mon Seigneur sous la plus belle des formes. . . » — hadîth que Corbin retient pour appuyer ses interprétations . La « validité noétique» de telles visions ne peut être niée ou dépréciée et il est clair qu’elles se situent dans le monde imaginal. L’erreur est d’en faire un nec plus ultra. « N’atteint l’Être dans son absoluité que celui qui a tout perdu (al-muflis) et dont la contemplation est exempte de toute forme » affirme Ibn ‘Arabi, qui enchaîne sur une citation du verset 24:39 où les œuvres des mécréants sont comparées à un mirage : l’homme altéré croit y voir de l’eau ; mais lorsqu’il y parvient, « il découvre qu’il n’est rien mais il y trouve Dieu ». C’est-à-dire, écrit Ibn ‘Arabi, « qu’il trouve Dieu dans le rien » (wajada Llâha ‘indahu, ya ‘ni (inda lâ shay’an) . On peut rapprocher cette exégèse de celle que Maître Eckhart donne du verset des Actes des Apôtres où est décrite la vision qui aveugle Saint Paul sur le chemin de Damas (AC. 9,8) : « quand il se releva de terre, les yeux ouverts, il vit le néant et ce néant était Dieu » . Un tel rapprochement n’a rien de fortuit : chez le shaykh andalou comme chez le docteur thuringien, la connaissance suprême n’est atteinte qu’au-delà des images et requiert donc ce qu’Eckhart désigne par le terme d’Entbildung. Le tajallïsuwarï, si précieux qu’il soit, ne constitue encore qu’une approche imparfaite de la Réalité ultime. Il doit être dépassé afin que l’absolu se révèle dans le sans-forme, dans le « rien ». Alors, «c ‘est le regard de Dieu qui saisit Dieu et Le voit et non le tien » . Si la demande de Moïse — « Fais-Toi voir à moi afin que je Te regarde » (Cor. 7: 143) s’est vue opposer le « Tu ne Me verras pas ! », c’est que le « tu» est de trop : dans le Temple de l’Unitude, il n’y a pas de place pour deux. L’accès en est interdit à celui qui n’a pas tout perdu.
Dénoncer les partis-pris de Massignon ou relever certaines faiblesses méthodologiques de ses recherches n’est pas mettre en cause l’importance de sa contribution à l’islamologie contemporaine. Récuser des thèses qu’Asin Palacios défendit avec ardeur n’est pas nier la richesse de ses vastes travaux sur Ibn ‘Arabi. Il n’en va pas autrement de Corbin. J’ai choisi d’exprimer ici des réserves sur trois points où sa lecture du corpus akbarien me paraît fautive ou insuffisamment pénétrante: il n’a pas perçu assez clairement la fonction matricielle du Coran dans l’expérience personnelle d’Ibn ‘Arabi et dans la genèse de ses écrits ; il voit en lui, contre toute vraisemblance, un soufi antinomien et un shï’ite de cœur qui, masquant ses convictions, ne peut que les trahir ; hypertrophiant enfin la notion de khayâl il mutile un enseignement initiatique qui vise à conduire le viator au sein de l’abîme divin, laissant derrière lui les perceptions visionnaires. À chacun d’apprécier la pertinence de ces remarques. Elles ne prétendent pas effacer la dette des études akbariennes envers Henry Corbin : l’étendue de son influence sur les scholars occidentaux et sur les chercheurs arabes eux-mêmes[1] interdit de l’oublier. Mais elle invite aussi à une réception critique. L’œuvre considérable qu’Henry Corbin nous a laissée et qui ne se limite pas, il s’en faut de beaucoup, aux pages qu’il a consacrées à Ibn ‘Arabî — ne perdra rien à être relue avec un respect sans complaisance.