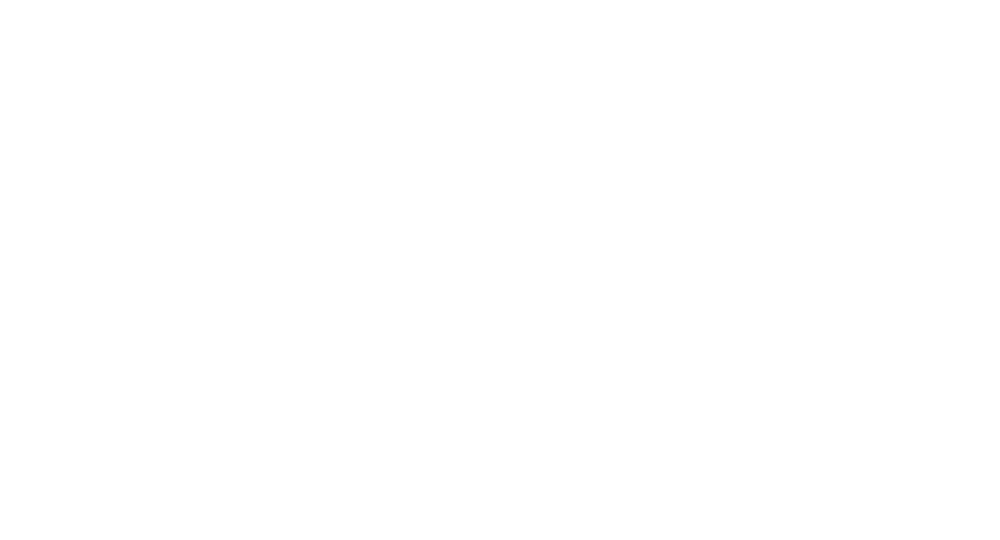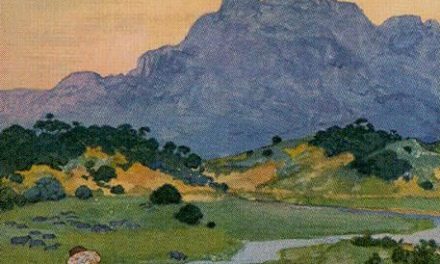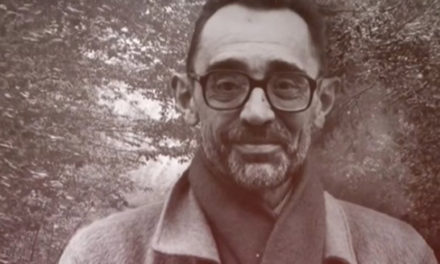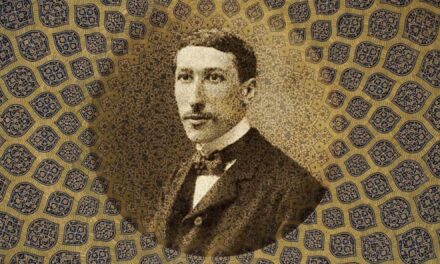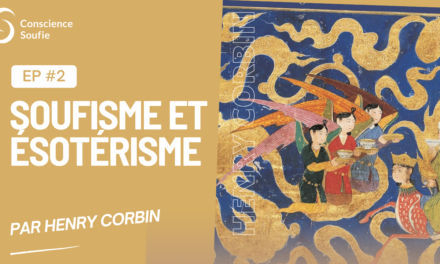Quand on parle de « prière » en français, on parle d’ « acte d’adoration ». En islam, cette définition de la prière (ṣalât ) correspond à la prière rituelle, deuxième pilier de l’islam, qui s’inscrit à travers un corps à la fois en méditation et en action, et s’accomplit selon des récitations et des gestes bien précis. D’un autre côté, lorsque l’on considère « la prière sur le Prophète » (al-şalât ‘alâ al-Nabî), on sous-entend la prière du croyant adressée à Dieu afin qu’Il prie, Lui, sur le Prophète.
Nous avons donc la configuration suivante : d’une part le croyant qui « prie » Dieu, c’est-à-dire qui adresse une demande à Dieu, et d’autre part Dieu qui est sollicité pour « prier » sur le Prophète. Ici, la ṣalât du croyant est synonyme de « demande », comme le verbe « prier » en français est synonyme de « demander ». Quant à la ṣalât de Dieu Lui-même, interrogeons-nous puisque, selon notre entendement ordinaire, Dieu ne « prie » pas, mais « est prié ». Nous en déduisons que le terme şalât dans un usage divin revêt une signification singulière, qui pourrait nous permettre l’interprétation suivante : Dieu, en réponse à la demande du croyant, « gratifie » le Prophète de Sa « grâce ». Dans ce cas, c’est Dieu qui accomplit l’acte, c’est Lui l’Agent.
Considérons alors la formule la plus courante de cette « prière sur le Prophète » que nous pourrions traduire de cette manière : « Ô mon Dieu, accorde Ta grâce à notre seigneur Muhammad ainsi qu’à sa famille et à ses Compagnons, et accorde-lui Ta paix » (Allahumma şalli ‘alâ sayyidinâ Muḥammad wa ‘alâ âlihi wa şaḥbihi wa sallim),
Comment comprendre la « prière sur le Prophète » ﷺ ?
Appliquons notre effort de définition à la traduction de ce fameux verset coranique : « En vérité, Dieu et les anges appellent la grâce (yuşallûna) sur le Prophète ; ô vous qui avez la foi, appelez sur lui la grâce (şallû ‘alayhi) et adressez-lui vos salutations (wa sallimû taslîman)[1].»
À présent, observons l’effet de miroir qu’opère cette ṣalât : Dieu invite les croyants à appeler sur le Prophète la grâce et la paix, en précisant que c’est ce que Lui-même et les anges font. En réponse à cette injonction, les croyants demandent à Dieu de « prier » (şalli) « Lui-même » sur le Prophète, car Il est plus Savant concernant ce qu’il sied à Son Prophète ﷺ. Au sein de cette dynamique axiale qui part de Dieu vers l’homme, puis remonte de l’homme vers Dieu en passant à chaque fois par le Prophète ﷺ, le bénéficiaire est avant tout le croyant, comme cela est précisé à multiples reprises dans le ḥadîth. Pour exemple, citons le propos suivant, rapporté par Abû Dâ’ûd : « Nul n’appelle la Paix sur moi (yusallimu ‘alayya) sans que Dieu ne me rende mon esprit (rûhî) afin que je rende le Salut (al-Salâm) ». Par la Grâce divine qui lui est accordée, le Prophète ﷺ se fait donc le « récepteur », puis « l’émetteur » de cette Paix vers tous ceux qui pratiquent la « prière sur lui ».
Que signifie exactement le mot ṣalât ?
Le mot şalât est issu d’une racine arabe dont le verbe simple şalâ signifie « brûler ardemment ». De fait, le verbe dérivé şallâ ne signifie pas seulement « prier », mais aussi « embraser ». Notons par ailleurs que le mot Ramaḍân, le mois du jeûne rituel, quatrième pilier de l’islam, partage ce même sens d’embrasement. De la sorte, comprenons que le « feu » (nâr), élément purificateur, est aussi « lumière » (nûr), s’agissant d’actes d’adoration.
De plus, le mot ṣalât est souvent associé sémantiquement à un mot issu d’une racine proche, celui de şila, le « lien ». Or, si la ṣalât, en tant que prière rituelle accomplie cinq fois par jour, constitue le moyen par lequel le serviteur reste en « lien » avec Dieu, la ṣalât sur le Prophète maintient également le « lien » avec le Prophète ﷺ à travers le temps et l’espace, comme nous avons pu le voir dans le ḥadîth précédent.
Quel est le sens profond de cette « prière » ?
S’agissant de la « prière sur le Prophète », le cheikh al-‘Alâwî (m. 1934)[2] explique que la signification du mot ṣalât diffère selon celui qui la pratique (al-muşallî) et selon son bénéficiaire (al-muşallâ). Lorsqu’elle émane de Dieu, elle est d’une autre nature que la prière pratiquée par Ses créatures : la ṣalât divine, est un acte (fi‘l), la ṣalât humaine est une parole (qawl) ; la ṣalât divine est une théophanie (tajallî), la ṣalât du croyant est une demande, une invocation (du‘â’).
Puis, le cheikh nous livre le sens ésotérique de la « prière sur le Prophète[3] » : « Lorsque l’on dit la ṣalât sur le Prophète, c’est comme si l’on disait Ô Dieu, manifeste-Toi à Muhammad et à sa famille. Car si la ṣalât n’était pas une théophanie, le Prophète ﷺ n’en aurait pas eu le désir, et ne nous aurait pas incités à la réciter en sa faveur en tout temps et tout lieu. »
Le cheikh ajoute que « la ṣalât de Dieu envers Ses serviteurs est l’expression de Son amour absolu pour eux ainsi que de Son immense proximité avec eux. Si cette ṣalât divine parvient à l’un de Ses serviteurs, celui-ci atteint le « tout » (kull). C’est par cette prière que Dieu extrait Ses saints (awliyâ’) de l’entrave (qayd) de leur âme charnelle pour les mener à Sa contemplation (mushâhada) ». Et le cheikh cite le verset coranique suivant : « C’est Lui qui étend Ses grâces (yuşallî) sur vous, tout comme le font Ses anges, afin de vous faire sortir des ténèbres pour vous mener vers la lumière.[4] ».
Le cheikh al-‘Alawî complète son propos en précisant le rôle de la paix (al-salâm), qui accompagne la ṣalât : cette paix divine accordée aux serviteurs apporte la sécurité (amân) et la stabilité (ithbât) dans la manifestation divine (tajallî). Il recommande donc de ne pas demander à Dieu al-ṣalât , sans la faire suivre d’al-salâm, car si Dieu accordait à l’un de Ses serviteurs la ṣalât sans le salâm, cela pourrait générer un grand danger : dans son trouble extatique, le serviteur pourrait proférer des paroles qui risqueraient d’être mal interprétées par le commun des mortels…
Il précise que le parfait équilibre entre ṣalât et salâm est atteint par les héritiers des prophètes (warathat al-anbiyâ’) : ce sont des êtres qui extérieurement sont avec les créatures (al-khalq), mais qui intérieurement sont avec le Réel (al-Ḥaqq). Il compare ces deux stations ṣalât et salâm aux deux états, décrits par les soufis, d’« ivresse » (sukr) et de « sobriété » (saḥw) ou encore d’ « extinction en Dieu » (fanâ’) et de « permanence en Dieu, mais parmi les hommes » (baqâ’) : lorsque Dieu Se manifeste, les élus se fondent dans Sa contemplation, c’est l’ivresse ; lorsqu’ils reviennent vers les hommes tout en restant en Dieu, c’est la sobriété. Le Cheikh al-‘Alâwî conclut que les prophètes ont la particularité de toujours recevoir la grâce (ṣalât) accompagnée de la paix (salâm).
Grâce à cet éclairage, nous remarquons que la relation entre le verbe şallâ « embraser » et le nom ṣalât , « prière » de Dieu en tant que théophanie, n’est pas sans rappeler l’histoire de Moïse, qui, face au Buisson ardent, se retrouve en présence de Dieu[5]. De la même manière, la paix (salâm), en tant qu’« apaisement » après la « brûlure » de la théophanie, est à mettre en lien avec le passage coranique où Dieu ordonne au feu de devenir « fraîcheur et paix » (bardan wa salâman) à l’égard d’Ibrâhîm poussé dans le brasier par ses ennemis[6].
Ainsi, la « prière sur le Prophète » occupe un statut de premier ordre en islam, et participe hautement de la foi du musulman. Elle est attestée par le Coran et le ḥadîth comme le moyen par excellence pour se rapprocher de Dieu, par l’intermédiaire de Son prophète-intercesseur ﷺ. Chaque musulman est invité à en expérimenter les vertus et à en goûter les bienfaits, en tout lieu et en tout temps, à travers les multiples expressions que la littérature pieuse a produites. Les gens de science parlent d’un secret la concernant, et nous constatons que, malgré tous nos efforts de compréhension, un voile de mystère subsiste. Dès lors, la « prière sur le Prophète » ne serait-elle pas, au-delà des mots et de notre perception première, la clé de la réalisation de l’humain en ce monde ?
[1] Coran 33 : 56.
[2] Cf. Ahmad al-‘Alâwî, Dawhat al-asrâr fî ma‘nâ al-şalât ‘alâ al-Nabî al-mukhtâr ; traduit sous le titre de L’Arbre aux Secrets ou de la signification de la prière sur le Prophète, par Nabil Badrawî, Ed. Albouraq, 2003.
[3] Cf. Ahmad al-‘Alâwî, Al-Minaḥ al-quddûsiyya ; traduit sous le titre de Les très saintes inspirations ou l’éveil de la conscience, par Ahmed Benalioua, Ed. Albouraq, 2015.
[4] Coran 33 : 43.
[5] Coran 20 : 9-12.
[6] Coran 21 : 69.
Retrouvez la Revue Conscience Soufie Numéro 4 en ligne . Vous y découvrirez son dossier spécial consacré à la « Présence du Prophète ﷺ », ainsi que des portraits et des témoignages saisissants, le tout magnifiquement illustré par la miniature, l’enluminure et la calligraphie, notamment celle de Nuria Garcia Masip, et les photos de Roland Michaud.https://www.calameo.com/read/007294180361a4e13db8f
********************
Néfissa Roty-Geoffroy, membre actif de Conscience Soufie, professeure certifiée d’arabe et enseignante-formatrice de français langue étrangère et seconde (FLE-FLS), à la retraite, co-auteure du Grand livre des prénoms arabes aux éditions Albin Michel et albouraq (2009).