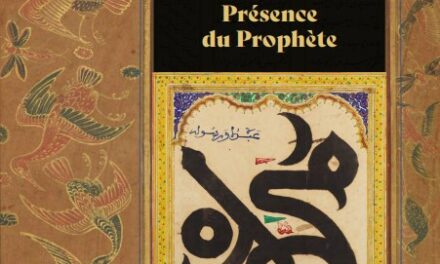Lors de la première édition de mon livre L’islam sera spirituel ou ne sera plus, en 2009, des lecteurs m’avaient écrit pour me dire qu’ils trouvaient que je forçais le tableau et que mon titre était provocateur. Mais les mêmes m’ont avoué récemment que ce titre s’est depuis révélé malheureusement pertinent.
Une crise mondialisée du sens
Jusqu’au début du XIXe siècle, nous étions encore dans des processus d’évolution auxquels sont soumises toute société humaine et toute religion. Nous étions à l’aube de l’hégémonie occidentale, notamment sur les pays musulmans, et de l’entreprise colonialiste. Dans une lettre datée de 1814, le penseur et poète allemand Goethe pouvait écrire à son fils : « Si islam signifie soumission à Dieu, alors nous vivons et mourons tous dans l’islam[1] ». On lui attribue également cette parole : « Si tel est l’islam, alors nous sommes tous musulmans ! » Comment se fait-il que la perception de l’islam ait connu une telle inversion de sens depuis ces trente dernières années ?
C’est que, depuis, nous vivons la postmodernité et ce qu’elle charrie : mort des certitudes présumément acquises par la modernité, tsunami de la mondialisation, médiatisation immédiate de tout ce qui se passe dans le monde, et en premier lieu des scandales géopolitiques et humanitaires qui ne peuvent plus se voiler d’hypocrisie.
Nous sommes ainsi témoins d’un nihilisme radical. Chez certains musulmans, il s’exprime par un malaise civilisationnel, postcolonial, par une culture viscérale du ressentiment. Dès lors, l’islam ne pouvait qu’être dévoyé, transmuté en idéologies qui, en définitive, le nient.
Le « djihadisme » actuel est l’enfant naturel des scléroses successives qu’a connues la religion islamique et les « visées ultimes » (maqâsid) de sa Révélation. Il est l’avorton du wahhabisme saoudien, que les Occidentaux – et en premier lieu les Américains – ont soutenu de façon sordide[2]. Et de même que l’Europe a exporté le positivisme matérialiste et l’idéologie techno-scientiste, l’Arabie a exporté le cancer wahhabite. Si ce n’est qu’entre-temps l’effet boomerang a opéré, et le régime saoudien cherche désormais à évacuer très vite chez lui les métastases…
La ‘‘révolution’’ spirituelle
Il n’est donc plus temps de « réformer » l’islam, y compris par les divers procédés de l’ijtihâd ou « effort accompli sur soi-même, pour comprendre et adapter les données de la Révélation ». Prenons un exemple explicite de dévoiement de l’esprit de réforme en islam. À la fin du XIXe siècle, il y a eu un bel élan de réforme au Proche-Orient, promu en particulier par Jamâl al-Dîn al-Afghânî (m. 1897) et Muhammad ‘Abduh (m. 1905). La lutte qu’ils ont menée contre le fatalisme des sociétés musulmanes paralysées par l’impérialisme européen, la ‘‘raison’’ islamique qu’ils entendaient faire prévaloir, ne les ont pas empêché de vivre leur spiritualité d’obédience soufie. Or, celui que l’on présente communément comme le successeur de ‘Abduh, Rashîd Ridâ (m. 1935), a totalement ossifié l’élan réformiste de ce dernier. Cela se traduit dans les termes mêmes : le mouvement s’était lui-même nommé la Salafiyya, soit « ceux qui se réclament des premières générations de musulmans », lesquelles étaient novatrices et audacieuses. Ils signifiaient par là qu’ils refusaient de suivre aveuglément les avis théologiques et juridiques accumulés, ‘‘sédimentés’’ au cours des siècles. Or, cette Salafiyya, vivifiante à ses débuts, a dégénéré dans le salafisme que l’on connaît. En effet, voyant dans le nouvel État wahhabite qui naissait en Arabie un pouvoir fort pouvant compenser l’effondrement du califat ottoman en 1924, Rachid Ridâ s’en est rapproché en prenant une orientation réactionnaire et conservatrice, totalement opposée à celle de ses maîtres.
En français, réformer signifie « améliorer, amender une institution », c’est-à-dire la « ramener à une forme meilleure ». Nous sommes donc bien dans le domaine des formes. Or, la forme, si elle est privée de son ‘‘sens intérieur’’ (ma‘nâ), se dessèche, meurt, et peut elle-même être mortifère. Il ne sert donc à rien de changer l’écorce par une autre écorce : le fruit doit être régénéré de l’intérieur, à partir de son « cœur (lubb) ». La spiritualité est tel un noyau toujours en fusion qui vivifie et modèle l’écorce de la forme religieuse. Si ce n’est pas le cas, celle-ci se dessèche vite en idéologie.
Dans ses diverses métamorphoses, économico-techno-scientiste comme religieuse, le matérialisme non seulement ne produit plus de sens, mais accouche du non-sens. La compréhension sclérosée de la Sharî‘a mène au littéralisme desséchant, tandis que l’utopie consumériste du « progrès » mène aux crises, en particulier écologique, que nous connaissons. Dans les deux cas, le ciel de la spiritualité s’est refermé.
Toutefois, une large prise de conscience de la désagrégation et du nihilisme actuels semble provoquer le retour du balancier, c’est-à-dire la réémergence de la spiritualité sous des formes renouvelées. En effet, si le monde phénoménal n’a plus de sens, de deux choses l’une : soit la réalité se limite à cette perception, ce qui implique que Dieu et l’homme sont morts ; soit le sens est ailleurs, au-delà de nos perceptions empiriques, dans la Réalité cachée, la Haqîqa des soufis. C’est ce qu’induisent de plus en plus de scientifiques : confrontés, depuis Heisenberg et Gödel (entre 1920 et 1930) à l’incomplétude, à l’imprédictibilité, à l’incertitude du monde visible, ils sont obligés de faire un saut épistémologique considérable : Dieu serait-il le seul Réel, le Haqq des soufis, et ainsi le nihilisme ne serait-il que le miroir de nos illusions ?
[1] Cette lettre figure aussi dans le West-Östlicher Divan du poète.
[2] Lire à ce sujet, de Hamadi Redissi, Le Pacte de Nadjd, ou comment l’islam sectaire est devenu l’islam¸ Seuil, Paris, 2007. Le titre est explicite.