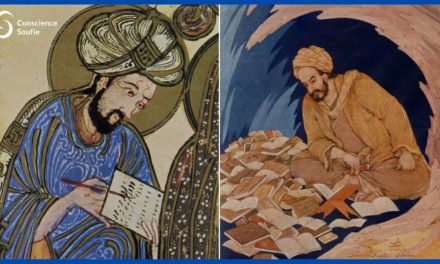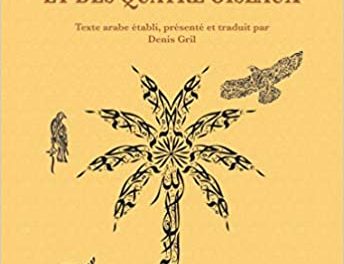Retranscription de l’émission de France Culture À voix nue : grands entretiens d’hier et d’aujourd’hui du 19 mars 1992.
L’article suivant correspond au dernier épisode d’une série radiophonique consacrée à Michel Chodkiewicz (décédé en mars 2020), spécialiste d’Ibn ‘Arabî. L’entretien est conduit par Jean-Maurice de Montremy.
Ce travail écrit a été mené par l’association Conscience Soufie, à l’occasion de l’événement organisé en septembre 2020 autour de L’enseignement d’Ibn ‘Arabî. En cela, Conscience Soufie vise à transmettre la sagesse universelle du soufisme en faisant connaitre ses grandes figures à travers les temps, et ses œuvres majeures.
le Podcast
Jean-Maurice de Montremy : « Il nous faut des maîtres terrestres. » C’est une idée qui revient souvent dans vos écrits, Michel Chodkiewicz, et, bien sûr, dans les écrits d’Ibn ‘Arabî, qui vous est cher. Peut-être également, dans toute la tradition islamique. La révélation divine ne peut pas venir sans un homme qui a reçu de Dieu cette révélation, non plus sans les maîtres terrestres. Ceux-ci sont des guides pour le croyant, qui ne peut se débrouiller dans notre monde sans avoir quelques références humaines auxquelles s’adresser. Pour ce quatrième entretien, cette question des maîtres terrestres va nous guider, car c’est une des choses qui est à la fois très recherchée par les hommes d’aujourd’hui, mais qui semble singulièrement absente.
Jean-Maurice de Montremy : « Il nous faut des maîtres terrestres. » C’est une idée qui revient souvent dans vos écrits, Michel Chodkiewicz, et, bien sûr, dans les écrits d’Ibn ‘Arabî, qui vous est cher. Peut-être également, dans toute la tradition islamique. La révélation divine ne peut pas venir sans un homme qui a reçu de Dieu cette révélation, non plus sans les maîtres terrestres. Ceux-ci sont des guides pour le croyant, qui ne peut se débrouiller dans notre monde sans avoir quelques références humaines auxquelles s’adresser. Pour ce quatrième entretien, cette question des maîtres terrestres va nous guider, car c’est une des choses qui est à la fois très recherchée par les hommes d’aujourd’hui, mais qui semble singulièrement absente.
Michel Chodkiewicz : Tout d’abord, il faut bien savoir que cette insistance sur la nécessité d’un maître terrestre n’est pas propre à Ibn ‘Arabî : elle est commune à toute la tradition du soufisme. Il y a un adage qui remonte à un grand soufi, un mystique musulman du IIIe siècle selon lequel celui qui n’a pas de maître, a Satan pour maître. Je dirais que, plus généralement, cela s’inscrit dans une nécessité ressentie à travers toute la tradition musulmane en matière de transmission d’un savoir, qui à nos yeux de modernes paraît profane : la grammaire, les mathématiques, la médecine, etc. C’en est au point qu’un grand auteur du XVe comme Suyûtî (c’était un Égyptien), qui avait acquis un certain nombre de sciences auprès de maîtres, mais qui pour une large part était un autodidacte (c’est-à-dire qu’il avait appris les sciences qu’il possédait dans des livres, sans avoir de maître) était considéré comme suspect. Donc cette notion de maître (’ustâdh, murshid ou shaykh sont les différents termes employés pour le désigner) n’est pas propre à la mystique : elle se trouve dans tous les compartiments de la civilisation musulmane. Une civilisation dans laquelle on ne peut recevoir de façon opérative une science quelconque que si on la tient, soit du maître qui a posé cette science le premier, soit de « quelqu’un qui la tient de lui » ou encore de « quelqu’un qui la tient de celui qui la tient de lui ». Cette idée de chaîne se retrouve absolument partout.
Néanmoins, dans le cadre du soufisme, à proprement parler, il faut introduire une distinction. Le soufisme naît de la sainteté – parce qu’à l’origine se trouve toujours un saint – et il a pour objet de reproduire cette sainteté, c’est-à-dire de conduire un certain nombre d’êtres vers une sainteté de quelque manière comparable à celle du saint fondateur de cette tradition.
On rencontre là un paradoxe, car la sainteté n’est donnée que par Dieu. Autrement dit, la sainteté s’inscrit dans un axe vertical. Elle ne peut atteindre sa plénitude que si elle vient d’en haut. En même temps, une généalogie terrestre est nécessaire. Au fond, c’est assez comparable à l’idée de la « naissance » au sens charnel du mot, car si Dieu est le Créateur, il n’en a pas moins choisi de se voiler derrière les causes secondes : ainsi, notre naissance s’opère par l’intermédiaire de géniteurs terrestres.
Dans le soufisme, nous rencontrons des êtres que l’on appelle des majdhûb, c’est-à-dire des êtres qui ont été arrachés par Dieu, et qui ont survolé les étapes de la Voie, pour arriver de façon soudaine à un état spirituel élevé. Ces êtres-là, qui n’ont donc pas l’expérience du pas à pas sur la Voie, sont certes des êtres spirituels respectés, mais ils ne sont pas considérés comme étant qualifiés à diriger les autres. Pour diriger, il faut avoir parcouru le chemin. En conséquence, ces êtres sans maîtres terrestres restent marginaux. De fait, ces personnages de majdhûb sont bien connus. C’est le cas précisément d’Ibn Arabi puisque les débuts de sa vie spirituelle s’opèrent sans maître terrestre.
Jean-Maurice de Montremy : J’allais vous poser la question. On sait que sa première illumination – je crois que l’on peut employer le mot – lui vient d’un maître qu’il n’a pas rencontré. Vous l’avez dit vous-même, il s’agit de Jésus …
Michel Chodkiewicz : Jésus, qu’il n’a pas rencontré en mode charnel, bien entendu. Il l’a rencontré en mode visionnaire, oui. Alors, précisément, pour se qualifier en tant que maître, il doit refaire les étapes de ce chemin qu’il a en quelque sorte survolé. Et c’est pourquoi on le voit se mettre au service d’un certain nombre de maîtres andalous dont il nous conte l’histoire, la vie et les miracles dans l’ouvrage que j’ai mentionné l’autre jour.
Jean-Maurice de Montremy : Tout homme qui a une perception de Dieu, et beaucoup d’hommes l’ont, heureusement …
Michel Chodkiewicz : Je dirais que du point de vue d’Ibn ‘Arabî, tous les hommes l’ont. Car même si elle s’est perdue, si le souvenir en est effacé, tous les hommes l’ont. C’est une notion islamique qui est fondée sur le Coran. Il y a l’idée du pacte primordial situé dans la prééternité à l’occasion duquel tous les hommes reconnaissent la présence et la souveraineté divines. Puis le souvenir de ce pacte s’efface chez certains. Au fond, tout le travail spirituel qui s’accomplit sous la direction des maîtres a pour but de réactualiser ce pacte dont le souvenir a été oublié et dont les conséquences n’ont pas été respectées.
Jean-Maurice de Montremy : Le rapport au saint, au saint homme, à l’homme qui va témoigner… C’est un phénomène qui est très remarquable en Méditerranée, disons à partir du premier ou du deuxième siècle de l’Empire romain.
Michel Chodkiewicz : Oui.
Jean-Maurice de Montremy : Nous savons que dans toute la surface de l’Empire, en Orient bien sûr, en Syrie, l’actuelle Palestine, dans l’actuel Liban (toutes ces régions qui n’avaient pas le même nom à l’époque romaine), il y a de saints hommes, qui ne sont pas tous forcément chrétiens à l’époque, les musulmans n’existent pas encore, bien sûr. Nous trouvons aussi ces saints hommes dans toute la sphère méditerranéenne du Maghreb (la future Tunisie, l’Algérie et le Maroc). Également en Gaule, où l’on sait que tout le christianisme français s’est développé autour d’un certain nombre de saints hommes, dont Saint-Martin est sans doute le plus célèbre. Nous avons l’impression que ce rapport au saint, qui dans beaucoup de pays d’Occident va s’identifier à la Bible, à L’Évangile, existe bien avant l’islam. La question que nous nous posons pour Ibn ‘Arabî est donc la suivante : est-ce qu’Ibn ‘Arabî n’est pas un de ces saints hommes des XIIe et XIIIe siècles, qui s’est référé au Coran plutôt qu’à l’Évangile, mais qui représente quelque chose de beaucoup plus ancien et peut-être de beaucoup moins musulman qu’on ne le croit.
Michel Chodkiewicz: Vous posez-là, en réalité, deux questions. Tout d’abord, Ibn ‘Arabî, n’est pas le premier saint en islam. Il y en a beaucoup avant lui, comme il y en a depuis l’origine. Dans les ouvrages hagiographiques, les premiers saints qui sont mentionnés sont les compagnons du Prophète ou, du moins, certains compagnons. Il est vrai que cette notion de sainteté (sans être totalement équivalente à la notion de la sainteté telle que définie dogmatiquement chez les chrétiens) est antérieure à l’islam et extérieure à l’islam. C’est-à-dire que sous une forme ou sous une autre, sous un nom ou sous un autre, nous la rencontrons ailleurs : dans le christianisme, mais aussi dans le judaïsme, et surtout dans le judaïsme tardif. Nous la trouvons en Inde, chez les taoïstes, chez les bouddhistes, et ainsi de suite. Cette idée qu’il y ait des hommes qui soient des témoins parfaits (ou presque parfaits) de la présence divine, et qui soient aussi des instruments de la présence divine et des médiateurs, est commune, je crois, à toutes les traditions religieuses. Elle prend en islam un certain nombre de traits distinctifs, mais il n’est pas absurde de considérer que, d’une certaine manière, elle est en solidarité avec d’autres formes de sainteté antérieures. Il y a d’ailleurs eu des thèses pour soutenir que le développement du soufisme en islam s’inspirait de l’exemple chrétien, de l’exemple des moines, des pères du désert, etc. Asin Palacios a joué un rôle dans la découverte d’Ibn ‘Arabî en Occident. C’était un ecclésiastique espagnol fort savant, qui a écrit un livre sur Ibn ‘Arabî au titre significatif : l’islam christianisado, « l’islam christianisé ». Que veut-il démontrer ? Sa démarche est très curieuse : il est sensible à l’influence qu’Ibn ‘Arabî et d’autres soufis ont eue sur la spiritualité chrétienne, et en particulier sur la spiritualité carmélitaine. Il n’est pas toujours en mesure de montrer les chaînons historiques, mais force est de constater, que très probablement, notamment en Espagne (c’est un pays où l’islam a été présent durant des siècles), la spiritualité chrétienne s’est inspirée de la spiritualité islamique. Mais, à ses yeux, ce n’est qu’un prêté pour un rendu. Car cette spiritualité islamique, celle d’Ibn ‘Arabî et des autres, ceux qui sont venus avant et ceux qui sont venus après, a été pour lui empruntée au christianisme. C’est une thèse qui aujourd’hui a perdu beaucoup de sa crédibilité, mais elle existe et le fait qu’elle ait été soutenue montre bien, en tout cas, que l’idée d’une certaine continuité de la sainteté, d’une certaine communauté de fonction entre le saint chrétien et le saint musulman était perçue depuis longtemps. Cela, je ne le conteste pas.
Jean-Maurice de Montremy : Si on était relativiste, ou historien des religions parfaitement positiviste, on dirait qu’au fond tout cela est du pareil au même, il n’y a pas de différence. Vous l’avez dit vous-mêmes : ces gens se rattachent pour les uns au christianisme, les autres au taoïsme, d’autres encore au bouddhisme où il y a également un rapport au maître important. Vous, personnellement, vous pensez qu’il y a une différence, néanmoins.
Michel Chodkiewicz : Oui, mais je ne vais pas parler de mon cas personnel. Certes, il y a des différences, j’en ai déjà mentionné quelques-unes. D’abord, le fait qu’il n’y ait pas en islam un statut canonique concernant la gestion institutionnelle. Ainsi, dans la mesure où il n’y a pas d’organisme de contrôle, cela confère un caractère spontanéiste à l’émergence du phénomène de la sainteté. Il y a un point sur lequel je voudrais insister car je ne suis pas sûr que vous le perceviez bien. Vous pouvez croire, parce que je parle d’Ibn ‘Arabî, ou parce que je fais allusion de manière très elliptique à mon expérience personnelle, aux gens que j’ai rencontrés, que tout cela est relativement marginal. Que finalement, cette notion de sainteté joue un rôle secondaire en islam. Et ce qui paraît confirmer vos vues, c’est qu’en effet il y a eu tout un courant en islam (bien antérieur au wahhabisme, mais qui a surtout pris de la force depuis son émergence au XVIIIe siècle) qui s’oppose farouchement au culte des saints, sans nier l’existence à proprement parler de la sainteté – parce que le terme même que l’on traduit par « saint » (awliyâ’) existe dans le Coran. Mais on a tendance à diluer cette notion. Finalement, pour les Wahhabites, un croyant pieux est un saint, n’est-ce pas ? Le terme de « wâlî » s’applique à n’importe quel homme droit, qui respecte ses obligations religieuses. Et, cela conduit les wahhabites (et les gens qui ont marché sur leurs traces) à condamner toute forme de respect des saints, de dévotion aux saints, d’attribution aux saints, de privilèges, de missions, de fonctions, etc. Mais ce courant a toujours été extrêmement minoritaire en Islam jusqu’à la fin du XIXe siècle, et aujourd’hui encore il reste minoritaire. Même s’il est très bruyant et se fait remarquer énormément.
Je vais vous raconter une petite histoire qui concerne un saint égyptien. C’est un saint du XIIIe siècle nommé Ahmad al-Badawî, qui venait du Maghreb, du Maroc exactement, qui vécut en Irak où il rencontra un autre grand saint Ahmed ar-Rifa’i, puis qui s’installa à Tanta en Égypte. Le culte de ce saint, la vénération qui lui est portée, provoquent chaque année, à l’occasion de son mawlid (l’anniversaire de sa naissance), un afflux de population absolument considérable. Des centaines de milliers de personnes viennent de tous les coins d’Égypte pour honorer ce saint. Avec des conséquences prévisibles quand il s’agit d’une réunion aussi importante ; je parle de l’aspect commercial propre à toute espèce de pèlerinage, mais aussi d’activités pas forcément recommandées par la religion.
Jean-Maurice de Montremy : Cela est rassurant.
Michel Chodkiewicz : Oui, mais cela donne un bon prétexte, évidemment, aux adversaires du culte des saints qui disent : « C’est scandaleux, on voit des hommes et des femmes mélangés, ils se passe des tas de choses scandaleuses », et ainsi de suite. Cette vénération, pour Ahmad al-Badawî, qui est sans doute le saint le plus populaire en Égypte, n’entraîne pas seulement vers son sanctuaire à Tanta des foules de paysans analphabètes, mais tout le monde y vient. Je connais de nombreux habitants du Caire qui sont d’honorables bourgeois, de respectables professeurs, des théologiens même, qui s’y rendent aussi.
Or, depuis des siècles, sans arrêt, des gens critiquent cela. Au début de l’année, le 3 janvier, je lisais dans al-Ahram, le journal égyptien, une lettre ouverte (et c’est sans doute la millième du genre) dénonçant une fois de plus ce pèlerinage, jugeant qu’il était scandaleux d’aller chercher l’intercession d’un saint, qu’on pouvait prier Dieu n’importe où et qu’on n’avait pas besoin des saints, et prenant comme cible en particulier le Ministère des Affaires Religieuses, qui autorise ce pèlerinage (car il a pour fonction administrative de déterminer le calendrier des saints, l’attribution à chaque saint particulier d’une fête à un certain moment, le déroulement des processions et ainsi de suite…). On reprochait donc dans cette lettre au ministère des Affaires Religieuses non seulement de permettre cela, mais de l’encourager. En dépit de toutes ces critiques (elles ont été très nombreuses et particulièrement virulentes à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe) cette vénération pour les saints perdure, et elle constitue un phénomène collectif qui brasse toutes les classes de la société. J’ai pris un exemple égyptien, mais je pourrais en prendre d’autres ailleurs.
Jean-Maurice de Montremy : Alors comment expliquez-vous que l’esprit moderne, l’efficacité moderne et même le succès moderne se soient construits en Occident autour d’une critique protestante du culte des saints ? On sait l’hostilité que les protestants éprouvent pour le culte des saints et même, dans certains cas, pour la vénération d’images (les protestants rigoristes refusent la présence d’images trop insistantes dans les temples). Comment expliquez-vous donc ce succès sociologique du protestantisme en Europe ? Et par ailleurs ce succès – qui semble assez fort – du wahhabisme ? Certes, celui-ci est tardif, mais il représente un peu ce refus du culte populaire, du culte des saints (qui est considéré comme une idolâtrie, comme un rapport naïf à la religion). Tout cela a fait le monde moderne. Le monde moderne est un monde qui a réussi économiquement, sociologiquement, avec tous les défauts qu’on sait, mais qui est là. Et ce monde s’est bâti massivement, dans le cadre du christianisme – comme dans le cadre de l’islam, semble-t-il – sur un rejet d’une certaine forme de spiritualité traditionnelle. Comment expliquez-vous, que finalement ce monde ait réussi et subsisté alors que ce que vous considérez comme peut-être plus humain, plus proche, soit considéré comme minoritaire ou récessif ? On considère que la religion populaire est quelque chose qui existe encore en dépit de tout et qui devrait disparaître.
Michel Chodkiewicz : D’abord le terme de « religion populaire » pose énormément de problèmes. Et je ne suis pas le premier à les soulever.
Jean-Maurice de Montremy : Je caricature.
Michel Chodkiewicz : Bien entendu, Ibn ‘Arabî n’est pas le premier à les soulever. Dans le cas du christianisme, vous connaissez la thèse de Peter Brown, qui démontre que loin d’être l’effet d’un spontanéisme populaire, le culte des saints a été déterminé par des évêques souvent issus de familles sénatoriales. Autrement dit, il procède d’une élite, qui a dirigé la foi dans ce chemin, et non pas simplement d’une espèce d’explosion anarchique venant du peuple. Alors, dans le cas de l’islam, il se produit quelque chose du même genre. C’est-à-dire que la célébration des mawlîd (anniversaires des saints) par exemple, c’est quelque chose qui procède d’en haut. L’institutionnalisation de ces formes de dévotions, parce qu’elles existaient d’une manière non-organisée jusque-là, s’est faite grosso modo à partir du XIIe siècle et sous l’impulsion d’une élite de soufis, qui étaient très intellectuels, et de souverains, qui les prenaient comme conseillers. Ici aussi le terme de « religion populaire » est impropre : il s’agit en effet de formes de dévotion pratiquées par le peuple. Mais s’imaginer que ces formes de dévotion proviennent de lui (et qu’il faudrait donc opposer un islam populaire à un islam savant) est une illusion à laquelle ont succombé par le passé beaucoup d’orientalistes, mais sur laquelle on revient actuellement.
Jean-Maurice de Montremy : Comment expliquez-vous le succès du wahhabisme ? Le succès d’une religion politique ou officielle, efficace, qui récuse justement tout ce qui peut ressembler à la religion populaire pour faire une sorte de religion nationale, ethnique, une identification des masses à un idéal religieux en essayant de rembarrer tous les intermédiaires trop humains. Ce qui existe également en Occident.
Michel Chodkiewicz : Bien sûr ! Alors, non seulement les wahhabites peuvent être comparés assez légitimement à un certain nombre de réformateurs dans le christianisme, mais, si on remonte plus loin, Ibn Taymiyya qui a vécu fin XIIIe – début XIVe siècles, et qui au fond est l’ancêtre du wahhabisme, peut être identifié d’une certaine façon à Luther. Dans la mesure où il élève des protestations contre des manifestations de la foi qu’il juge déviantes, de la même manière Luther proteste contre le trafic des indulgences, contre le culte des reliques, etc. Il est d’ailleurs significatif qu’au XIXe siècle, le relais du wahhabisme ait été pris sous une forme un peu différente par le courant qu’on appelle le courant salafiya en Égypte, représenté par des hommes comme le cheikh Abdou qui, visiblement très influencé par le protestantisme, cherchait à en donner une version islamique. C’est une influence évidente, reconnue et délibérée.
Je constate simplement que cette influence n’a pas été suffisante pour éteindre le culte des saints. Ce que l’on appelle assez improprement d’ailleurs, le « culte des saints ». Ce n’est pas parce que l’Occident est parvenu à un certain succès (technique, matériel, etc.), en abandonnant tout cela, qu’il faut y voir une relation de cause à effet. Je sais que c’est une thèse soutenue par certains historiens. Mais on peut penser que l’Occident aurait pu arriver à un certain progrès technique sans abandonner les formes de dévotion anciennes. Dans le cas de l’islam, je ne vois absolument pas pourquoi la réalisation sur le plan humain, terrestre, d’un certain nombre d’objectifs économiques, techniques, ou sociaux serait incompatible avec la vénération aux saints.
Jean-Maurice de Montremy : Restons dans la sphère de l’islam, de la sainteté… Concernant Ibn ‘Arabî, on est frappés par la façon dont vous exposez sa manière d’entretenir des relations avec la foi : c’est un homme libéral, souple, qui n’impose pas de lois trop excessives. Par ailleurs, on sait qu’il y a dans l’islam, ancien ou contemporain, une présence très forte des prescriptions. Comment une telle construction intellectuelle élaborée, une telle sensibilité mystique très forte, peut-elle s’accommoder de rites et d’obligations, qui nous paraissent à nous, Occidentaux (détachés des rites et des prescriptions), presque dérisoires ? Quelle nécessité y a-t-il de faire des rites de purification avant de prier, d’accepter des interdits alimentaires ? La mystique est une chose tellement haute et importante qu’on devrait pouvoir violer un rite alimentaire et être un bon mystique.
Michel Chodkiewicz : Du point de vue d’Ibn ‘Arabî, et de tous les auteurs dont il est le successeur (parce que beaucoup l’ont précédé dans cette voie, et quand je parle d’auteurs j’ai tort car beaucoup de saints ont écrit et beaucoup d’autres ne l’ont jamais fait ou étaient analphabètes), l’homme est un tout. Donc, la totalité de son être – c’est-à-dire la totalité des constituants de son être, la totalité des puissances de son être – doit être associée dans l’acte d’adoration divine, ce qui explique la part jouée par le corps. Dans l’anthropologie islamique (je parle en termes un peu généraux, je ne peux pas faire autrement ici), l’homme se définit en mode triple. On ne distingue pas le corps et l’âme seulement, n’est-ce pas ? Il y a l’homme spirituel représenté par le cœur, puis une position intermédiaire qui est occupée par l’âme, et enfin le corps.
La totalité de ces trois éléments, avec ce qu’ils comportent même d’éléments constituants, doit être totalement engagée dans le service de Dieu. D’où la raison d’être de rites où le corps a sa place. En effet, on peut trouver curieux que la prière doive être précédée par des ablutions, acte très pratique. Notons aussi que dans le christianisme, on a l’équivalent de cela : le signe de croix, par exemple, est un geste du corps. Il peut très bien être accompli de manière purement mécanique et n’avoir aucune signification profonde pour celui qui l’accomplit. Il peut aussi avoir un autre sens, et je pense que pour les saints chrétiens, il avait un autre sens. De la même manière, des actes extérieurs (le fait de se prosterner, le fait d’accomplir les ablutions, le fait de jeûner) peuvent être dépourvus de signification, tels une écorce vide. Mais, bien sûr, celui qui s’engage dans la voie spirituelle essaye dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses paroles, de rassembler tout son être.
Jean-Maurice de Montremy : Alors que pensez-vous de cette parole du Christ : « L’homme n’est pas fait pour la loi, mais c’est la loi qui est faite pour l’homme. »
Michel Chodkiewicz : Cette parole du Christ me paraît tout à fait juste, et elle correspond à un point de vue islamique. « La loi est faite pour l’homme », cela signifie pour nous que la loi a été révélée par Dieu et interprétée par le Prophète pour aider l’homme, non pas pour le contraindre. La loi n’est pas un châtiment, la loi est un moyen de grâce. Par conséquent, « elle est faite pour l’homme », et « l’homme n’est pas fait pour elle. Cela ne signifie pas que l’on ne doit pas respecter la loi, mais que la loi s’impose parce qu’elle est une miséricorde divine.
Ce qui introduit une différence entre les soufis en général – et Ibn ‘Arabî en particulier- et les juristes (ils sont nombreux en islam, c’est une corporation qui a toujours été très prospère), c’est que (j’ai déjà eu l’occasion de le dire pour Ibn ‘Arabî) la loi doit être interprétée dans le sens le plus conciliant et le plus irénique. Si l’on s’adresse à la communauté, chaque homme a le droit, pour lui-même, de choisir l’interprétation de la loi qui est la plus rigoureuse, et c’est bien entendu ce que fait Ibn ‘Arabî et ce que font tous les saints. Mais quand un savant, à quel que titre que ce soit, intervient pour interpréter la loi auprès de la communauté, il doit toujours chercher les solutions qui sont les moins pesantes.
Précisément, la loi a été voulue par Dieu comme une miséricorde et non pas comme une contrainte. Ce qui conduit concrètement à des interprétations de la loi qui sont, je ne dirais pas « plus laxistes », mais « plus accommodantes », « plus adéquates » (que ne le sont les interprétations habituelles des juristes) aux circonstances particulières de chaque être. Les musulmans, mais aussi les gens qui s’intéressent, par exemple, au problème des immigrés et de leur intégration, se posent souvent la question de savoir si la loi islamique est ou n’est pas conciliable avec les contraintes de l’existence moderne. Il y a effectivement des problèmes. Néanmoins, je pense qu’on trouverait plus aisément des solutions si, au lieu de s’enfermer dans les catégories juridiques (instituées par un certain nombre de grands hommes, d’ailleurs, il y a plusieurs siècles, et qui ont été surchargées de gloses et de complications par la suite), on revenait à des principes essentiels : ce qui compte c’est la parole de Dieu, non pas les interprétations qu’en ont données tel ou tel savant, tel juriste, à une époque déterminée en fonction de circonstances déterminées.
Les juristes ont su trouver des solutions qui s’accommodaient avec les circonstances. Je vais vous en citer un exemple très intéressant. Quand les musulmans ont occupé l’Inde, ils se sont trouvés en face d’une population majoritairement hindoue. Le problème s’est posé de savoir quel allait être leur statut juridique. Un certain nombre de juristes (certains étaient des soufis, d’autres ne l’étaient pas) ont conclu qu’au fond les hindous avaient un livre, le Veda. Par conséquent, on pouvait assimiler leur statut à celui qui était prévu par le Coran pour les ’ahl al-Kitâb, c’est-à-dire « les gens du Livre », dans le sens historique premier du terme : les juifs et les chrétiens. Il n’y avait pas eu de raison de se poser le problème avant, mais la rencontre avec une immense population qui n’était ni musulmane, ni juive, ni chrétienne, conduisit à faire évoluer le contenu de cette notion de ’ahl al-kitâb.
Fin de l’entretien.