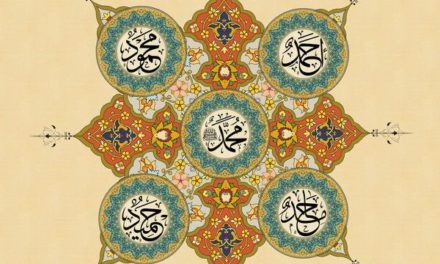Cheikh Ahmed Ould Mostefa Benalioua
La biographie du Cheikh Benalioua (Ahmed Ould Mostefa), tient en quelques mots. Son histoire ne sera jamais que celle de ses idées. Né à Mostaganem en 1872, d’une famille modeste, tour à tour ouvrier cordonnier, épicier, failli vers 1908, puis à la tête d’un nouveau commerce de comestibles, il parvient enfin à une petite aisance. Entre temps, il poursuit de fortes études religieuses, sous la direction du Cheikh Bouzid, des Derkaouas-Habrias, savant réputé dont il reste l’élève préféré. A la mort de Bouzid, en 1909, Benalioua voyage en Egypte, en Syrie, en Perse, dans l’Inde. C’est la partie mystérieuse et peu connue de sa vie. Au cours de ces pérégrinations, il apprend la thaumaturgie, l’ésotérisme, la théosophie, l’occultisme, et vraisemblablement, l’hypnotisme. A son retour, rupture avec les Derkaouas. Le voilà chef d’école. Son succès est éclatant, rapide, marqué par la fondation à Alger et à Mostaganem; de deux importantes zaouias et la direction de son journal hebdomadaire, en langue arabe, « El Balagh El Djezaïri ». Objet de l’adoration fanatique de ses fidèles, violemment attaqué par ses adversaires, les néo-wahabites et certains marabouts, il enseigne une doctrine troublante qui, pour beaucoup, est un moderne Evangile. Car il a, en même temps qu’une masse d’affiliés ignares, des disciples européens d’une haute culture. Sa propagande, servie par une rare éloquence, un savoir étendu, est infatigable et féconde. Elle électrise, en quelques jours, des douars entiers. Mais usé à cet apostolat de la plume et du verbe, affaibli par une ascèse ardente et de dures privations, Benalioua meurt à Mostaganem le 14 juillet 1934.
On demeure surpris du succès de son prosélytisme. Les Derkaouas dont il est issu et qu’il combattra, sont cependant en Oranie puissamment organisés. Il y a la branche des Oulad Mebkhout, à Méchéria, celle de Mostaganem, l’école de Mascara, les Oulad Lakred de Tiaret, les Benbrahim de Tagremaret, la zaouïa de Tircine (Saïda). Il y a aussi les affiliés pseudo-snoussistes du marabout Bentekouk dans l’arrondissement même de Mostaganem. Autant de résistances qui s’opposent à la nouvelle confrérie. Mais sa force de propulsion est si grande que, dès 1920, elle triomphe. Ignoré avant 1914, Benalioua surgit soudain après la guerre, pour devenir en quelques mois l’un des grands chefs religieux algériens.
Ce succès vient moins de la séduction de la doctrine que du prestige de son auteur.
Cheikh Benalioua était d’apparence chétive. Mais il émanait de lui un rayonnement extraordinaire, un irrésistible magnétisme personnel. Son regard agile, lucide, d’une singulière attirance, décelait l’habileté du manieur d’âmes et la force orgueilleuse sûre d’elle-même. Très affable, courtois, en retrait, tout de nuances et d’attitude volontiers conciliante, il réalisait à merveille le type du marabout déjà évolué. On sentait en lui une volonté tenace, une ardeur subtile qui, en quelques instants, consumait son objet. Il arrive que le religieux maghrébin soit à la fois réaliste et doctrinaire, sceptique et dogmatique, positif et mystique, par ce phénomène de « bovarysme » qui est la marque de certains apôtres de l’Islam. Il n’en était point ainsi de Benalioua. Nul ne saurait douter de sa sincérité, de sa probité spirituelle. Sa foi était débordante, communicative, toute en lyrisme jaillissant. Mais, en même temps, il gardait un sens aigu du fait et de son utilisation immédiate. Il appartenait à cette classe d’esprits si fréquents en Afrique du Nord, qui peuvent passer sans transition de la rêverie à l’action, de l’impondérable à la vie, des grands mouvements d’idées aux infinitésimaux de la politique indigène. Ces psychologies de marabouts déconcertent l’analyse. Elles procèdent de cette logique interne qui relie le fatalisme à l’exaltation de la volonté, la volupté orientale à l’éthique de Ghazali.
Nous avons connu Cheikh Benalioua, de 1921 à 1934. Nous l’avons vu lentement vieillir. Sa curiosité intellectuelle s’aiguisait chaque jour et, jusqu’à son dernier souffle, il resta un fervent de l’investigation métaphysique. Il est peu de problèmes qu’il n’ait abordés, guère de philosophies dont il n’ait extrait la substance. Mais cette tension spirituelle, sa rigoureuse austérité, ont certainement abrégé ses jours. Vers la fin, il n’était plus qu’une abstraction hautaine, fermée, dédaigneuse de la vie.
Sa philosophie
Le Cheikh Benalioua fut d’une rare émotivité métaphysique. Il atteignait d’un élan les hauts sommets de l’ontologie. Son ingéniosité était extrême, et il excellait à vêtir d’une métaphore, d’une allégorie charmante, la sécheresse des idées. Dieu, disait-il, dans le privé, est comme une lumière pure. Son rayon illumine le Prophète.; il m’a illuminé à mon tour. Mais au fur et à mesure qu’il descend sur l’homme, sur les hôtes, les plantes, les minéraux, le rayon s’alourdit de matière. De sorte que, pour retrouver en nous son Essence, il faut fondre cette matière au feu brûlant de l’Amour. La vapeur, l’eau, la glace sont une substance unique ; elles donnent de Dieu et de ses dégradations dans l’espace, une image suffisamment approchée.
Nous avons eu l’occasion d’exposer à Cheikh Benalioua divers systèmes philosophiques de l’Occident. Il les comprenait à merveille. Mais sa dilection allait à la métaphysique de M. Bergson, qu’il regrettait amèrement de ne pouvoir suivre dans le texte. Il en saisissait, dès l’exposé verbal, les finesses les plus ténues et les traduisait sur le champ par une image éclatante. Il nous commenta ainsi la célèbre distinction entre l’intelligence-outil, et l’instinct-intuition seul capable d’appréhender la vie : la charrue du fellah s’est substituée à la plume du taleb. L’explication que donne M. Bergson de la sophistique des Eléates le ravissait et il tirait d’ingénieux apologues de la fameuse flèche de Zénon.
L’œuvre écrite du Cheikh Benalioua ne porte guère trace de ses incursions dans la philosophie moderne. Soit qu’il les jugeât inopportunes ou dangereuses, soit qu’il n’y vît qu’une manière de dilettantisme renanien, ses réflexions s’adressaient surtout, au cours d’entretiens intimes, à ses amis européens. Il montrait alors sa ferveur des grands jeux de l’esprit. Agile et légère, sa dialectique effleurait les problèmes. Elle les renouvelait, les avivait au passage d’un brillant trait de pourpre. Il platonisait avec une grâce élégante. Son imagination primesautière, chatoyante, infiniment nuancée, s’installait d’un coup d’aile dans les systèmes les plus abrupts. Et son amitié des idées était si passionnée, qu’il les apaisait, les réconciliait, les fondait dans une large synthèse d’amour.
Sa morale
Pas plus qu’il n’a érigé une doctrine politique, Benalioua n’a construit d’éthique qui lui soit personnelle.
Sa morale, celle qu’il préconisait devant ses disciples, est celle des Derkaouas. C’est, avant tout, une morale religieuse, une annexe de la prédication confrérique. Vivre simplement, dans l’abstinence et la prière, pratiquer l’aumône, éviter la société des puissants, être humble de parole et d’habit, tels sont ses préceptes généraux. Mais il semble bien qu’au cours de ses dernières années, le Cheikh ait élargi sa conscience de l’humanité. Il faisait, dans ses conversations, une place de plus en plus grande à la charité. Il prêchait l’oubli des injures, la nécessité du pardon. « Aimez-vous les uns les autres… » Cette formule, qu’il conseilla d’abord aux Musulmans, il finit par l’étendre à toutes les races, à toutes les confessions. Il avouait dans le privé professer la doctrine de l’Ahmadiya indienne, avec laquelle il entretenait des rapports assidus; la fraternité avec Dieu commande une ardente charité. Il « enseigne la fraternité aimante des hommes », écrira M. Probst-Biraben. De fait, il était parvenu à une sorte de tolstoïsme, où la résignation au mal se teintait de miséricorde, où le dédain de la vie s’éclairait d’une tendre sollicitude envers le prochain. Mais ce prochain, c’était aussi la bête, le végétal. Il s’exaltait en y songeant. Ses yeux profonds se mouillaient. Son effusion confondait dans un élan d’amour l’homme, l’animal et le brin d’herbe. Avec son lyrisme incisif, son sens de l’image biblique, son éloquence haletante, il apparaissait alors comme le poète de la souffrance universelle, le prophète inspiré de la réconciliation des âmes.
Cet amour cosmique fut sa suprême ascension. Quelque temps avant sa mort, il nous confia sa répugnance à s’alimenter. « Manger de la chair est un meurtre, disait-il. Et le végétarisme est lui-même un attentat contre « la vie. Il faut étendre la fraternité humaine aux animaux et aux plantes. C’est une horrible nécessité de ne pouvoir vivre qu’aux dépens des choses vivantes. Mais surtout, pas de crime inutile ! Cueillir une fleur est un comble de cruauté. C’est peut-être se fermer à jamais la haute miséricorde de Dieu. »
Ce sont les dernières paroles que nous aurons entendues du Cheikh Benalioua. Et nous nous sommes souvent demandé si cette large pitié universelle, ce dégoût d’une nourriture qui avait été chose vivante, n’ont pas aggravé la lente consomption dont il est mort.
Tel fut le Cheikh Benalioua.
Par Augustin Berque
Vous pouvez retrouver la publication d’origine sur le site Gallica ici.
Augustin Berque (1884-1946) , le père de Jacques Berque, fit toute sa carrière dans le corps des administrateurs civils de l’Algérie, d’adjoint stagiaire à directeur du service. Il sera directeur des Affaires musulmanes et des Territoires du Sud au Gouvernement Général de 1941 à 1945.