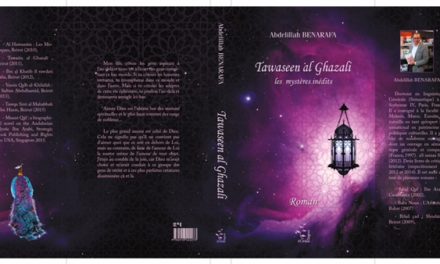La vie spirituelle, on le sait, est tissée de paradoxes, et elle en tire même sa pertinence. Dans l’histoire de la sainteté en islam, nul davantage que l’école des Malâmatis, née en Iran oriental (Khorassan) au IXe siècle[1], n’a illustré ce phénomène. Toutes les sociétés traditionnelles – islamique ou autre – étaient en quête des saints, sources de bénédiction. Or, dès lors que j’ai acquis une réputation de sainteté, comment préserver ma sincérité et l’intimité de ma relation à Dieu, toujours susceptible d’être corrodée par la relation humaine horizontale ?
Cette exigence implacable d’authenticité a emprunté, chez les Malâmatis, deux modalités en apparence opposées. L’une consiste à ne laisser aucune surface à l’ego, à « être un caillou dans la main de Dieu », à chercher l’anonymat en s’occultant dans la société. L’autre attitude part du principe que « celui qui est agréé par Dieu ne doit pas l’être par les hommes ». L’humain qui suit cette logique cherche donc à s’attirer le blâme (malâma) de son entourage en transgressant ostensiblement mais en apparence seulement la norme sociale et religieuse (outrage aux bonnes mœurs, laxisme dans l’application de la Loi…). De saint, il devient, aux yeux des hommes, un être dépravé, un imposteur : la partie est gagnée, et la sincérité retrouvée… Des oulémas, notons-le, ont justifié de tels comportements, considérant que « commettre certains interdits est moins nuisible pour l’âme que l’infatuation de soi-même ». Mais, d’évidence, cette éthique périlleuse a engendré bien des abus et des contrefaçons, comme en témoignent les Kalandars des Mille et Une nuits.
La première modalité – intravertie – impose à l’ego une sobriété absolue, un enfouissement de toutes ses velléités. La seconde – extravertie – avilit ce même ego en le travestissant au regard d’autrui. La transparence face au scandale. Et pourtant l’un et l’autre types de Malâmatis pointent vers un même but : ne se permettre aucun décalage, aucune distorsion entre son état intérieur et sa conduite extérieure ; n’avoir aucune complaisance à l’égard des faveurs spirituelles que l’on reçoit et, il va de soi, des prétentions mondaines.
Mû par un souci inaltérable de la lucidité, le Malâmati traque donc l’hypocrisie sociale ; son non-conformisme foncier a – surtout dans sa version extravertie – bien souvent choqué la société musulmane bien-pensante. Ce type de sainteté est bel et bien repéré dans d’autres sociétés et religions. Surtout n’appliquez pas à ces êtres le terme « mystique » ! Il est trop entaché de prodiges et autres charismes. « Les gens du blâme » sont les bienvenus dans nos sociétés où le spirituel s’est affaissé dans le psychique, où la voie initiatique a versé dans le « développement personnel ». Leur voie peut même prendre chez nous des atours sécularisés, et certes il vaut mieux un Malâmati athée qu’un dévot plein de componction :
Au village, sans prétention,
J’ai mauvaise réputation […]
Mais les brav’s gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux…
Brassens avait choisi sa modalité. Et nous ? Que choisissons-nous : la bonne moralité, l’incognito ou la mauvaise réputation ?
[1] Précisons que l’Iran n’est devenu chiite qu’au début du XVIe siècle.