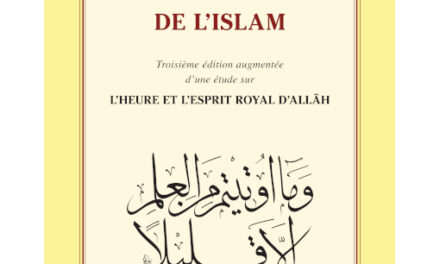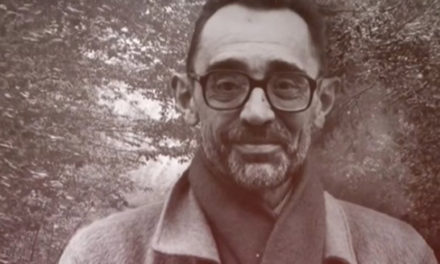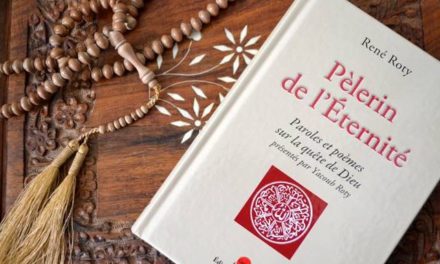Rencontre sur rencontre
Après avoir longtemps témoigné du parcours si singulier de cette femme d’exception qu’était Isabelle Eberhardt, ces deux aventuriers spirituels que sont Marie-Odile Delacour et Jean René Huleu ont répondu favorablement, et avec humilité, à l’invitation de Conscience Soufie : témoigner de leur propre parcours au fil des rencontres lumineuses qui ont forgé leur foi. Voici leur témoignage, à deux voix.
Suivre les traces d’Isabelle Eberhardt sur les pistes sahariennes et dans l’écriture de ses manuscrits nous a ouvert la Voie, nous projetant dans une aventure spirituelle que nous étions loin de pouvoir imaginer. Cette jeune femme, née en Suisse en 1877, fut une des premières Européennes à être initiée au soufisme, bien avant Frithjof Schuon et René Guénon. Attirée par la poésie orientale et les grands espaces du « Dâr al-islam », ce monde musulman qui la fascine et qu’elle parcourt à cheval vêtue en cavalier arabe, elle découvre la spiritualité soufie, et devient disciple de grands cheikhs sahariens de son époque, avant de mourir noyée, en plein désert, à 27 ans. Reconstituer ses parcours au Maghreb, rééditer ses écrits, nous a fait goûter à la richesse des rencontres. À force de suivre ses traces, sa trace s’est imprimée au plus profond de nous.
Marie-Odile Delacour – « Vous qui êtes féministe, vous avez dû entendre parler d’Isabelle Eberhardt ? me demande mon hôte, instituteur dans l’oasis de Timimoune, au cœur du Sahara algérien. Une Européenne habillée en bédouin qui a sillonné les pistes du Sahara. Elle est morte noyée en plein désert dans la crue d’un oued. On dit d’elle que c’était une espionne. »
Nous sommes dans une maison de toub, mélange d’argile et de paille. L’instituteur nous a conviés pour déjeuner, mon compagnon d’alors, Ali, moi-même et deux amis anglais. C’est le lendemain de Noël 1980. Je me suis étonnée à haute voix que cet instituteur, un homme frêle, ouvert et chaleureux ait demandé à sa femme de venir nous rejoindre autour de la table basse où trône un généreux couscous. Dans ce coin d’Algérie la non-mixité est une règle quasi absolue. J’apprécie que son épouse n’ait pas été reléguée dans la cuisine, et je le remercie de cette présence parmi nous.
De retour à Alger, avec toujours en tête le portrait insolite de ce personnage inconnu, je réside chez un architecte algérien dont la compagne est allemande. J’interroge cette dernière :
« Eberhardt, c’est un nom allemand… Isabelle Eberhardt, cela te dit quelque chose ?
– Ça alors, c’est extraordinaire que tu m’en parles. Regarde ! »
Elle me tend un exemplaire du Spiegel de la semaine précédente où elle me montre un dossier de plusieurs pages sur Isabelle Eberhardt, et me propose de me le traduire en français.
C’est le début d’une passion. Cet article – sans doute le meilleur de tous ceux que j’ai lus depuis, consacrés à Isabelle Eberhardt – me donne de nombreuses pistes de recherche sur sa trajectoire et son œuvre littéraire. Isabelle vient d’entrer dans ma vie et ne me quittera plus.
Jean-René Huleu – Je n’avais jamais mis les pieds dans ce café de la Place des Ternes au coindu faubourg Saint Honoré. J’y entre avec mon ami René pour digérer notre déconvenue devant une tasse de café. Depuis six mois, nous travaillons ensemble, avec quelques autres, sur un projet de magazine. « Le plus beau projet de presse que j’aie jamais vu », nous avait dit le PDG d’Europe 1 en nous faisant espérer un financement. La couverture montre le frais visage d’une jeune femme, avec cette exclamation : « Je t’aime ! ». Le journal des amoureux, en quelque sorte. Et même des amoureux du divin car ce projet est né de la réflexion d’un groupe de jeunes chrétiens charismatiques. Malheureusement, nous venons de sortir du siège d’Europe 1 après avoir entendu que notre PDG n’a pas réussi à convaincre son conseil d’administration de nous financer.
Il y a des moments comme celui-là où l’on sent qu’une page se tourne définitivement et le chapitre suivant est encore à écrire. J’ai la création d’une douzaine de titres de presse à mon actif, dont certains sont bien vivants. Mais au fond de ma déconvenue, je sens comme une envie de faire un pas vers l’inconnu, et pourquoi pas un voyage ?
J’en suis là de mes réflexions quand je me tourne vers le bar et immédiatement je l’aperçois. Marie-Odile, une journaliste de Libération dont j’ai fait la connaissance pendant la préparation de ce magazine. Depuis, j’ai toujours en tête cette sensation de lumière à l’instant où elle a ouvert la porte de mon bureau. Nous nous sommes vus à plusieurs reprises et elle m’a dit : « Je ne suis pas seule, j’ai rencontré un personnage de femme fascinant. Je voudrais écrire un article sur elle pour un magazine. » Je me retourne vers mon ami René et lui dis : « Combien crois-tu qu’il y ait de chances pour que l’on se rencontre comme ça, en plein Paris, dans un quartier que nous ne fréquentons ni l’un ni l’autre ? ». Sans réfléchir, il me répond : « Il te cherche ». Moi qui suis passé d’un athéisme farouche à un agnosticisme confortable, j’accueille ces mots avec émotion, mais sans plus. Et comme Marie-Odile me fait signe de venir la rejoindre, je me dirige vers le bar. « Cet après-midi, me dit-elle, il y a une lecture de quelques textes d’Isabelle Eberhardt sur France Culture, mais je n’ai pas le temps de les écouter. Peux-tu le faire et les enregistrer ? »
Installé dans le calme de mon bureau, que je vais bientôt quitter pour cause de cessation d’activité, je branche mon walkman sur le poste de radio et j’entends : « …sur le sentier qui longe le rempart, les femmes du ksar viennent à la fontaine de Sidi Embarek. Dans l’illumination du soleil couchant, leurs voiles ont des teintes d’une intensité inouïe. Les étoffes chatoient, magnifiées, semblables à des brocarts précieux. De loin, on dirait les ksouriennes vêtues des soies les plus rares, brodées d’or et de pierreries. Conscientes un peu de leurs grâces, ces femmes s’agitent, leurs groupes se mêlent et la gamme violente des couleurs change sans cesse, comme un arc-en-ciel mobile… ».
Quand, le lendemain, je revois Marie-Odile, je lui dis : « Ce n’est pas un article pour un magazine qu’il faut faire, c’est un livre ». Elle me répond : « Écrivons-le ensemble ».
M-O D – Nous allions signer un contrat avec les éditions Denoël. C’est alors que nous tombons sur un article de presse où Edmonde Charles-Roux, présidente du prix Goncourt et épouse de Gaston Defferre – alors ministre de l’Intérieur et maire de Marseille – annonce qu’elle allait entreprendre une « une biographie scientifique » sur Isabelle Eberhardt, « à l’américaine ». Denoël renonce aussitôt. Découragement, affliction, concertation, obstination… Nous décidons de passer outre et de nous atteler à une bio romancée. La fiction pour mieux appréhender la réalité de notre héroïne et surtout un voyage sur ses traces pour ressentir de l’intérieur, d’abord par l’expérience, ce qu’Isabelle Eberhardt a vécu. L’éditrice Liana Lévi accepte notre projet, malgré la concurrence ; et nous voilà partis en Algérie, où j’ai déjà fait plusieurs reportages pour Libération. Jean-René, qui avait refusé d’y aller en soldat, avait décidé de ne jamais y mettre les pieds.
Nous sommes en 1984, c’est la première fois que nous partons en voyage ensemble. L’épreuve du feu, dans un pays où, soyons francs, rien n’est simple. Nous nous lançons, non sans appréhension, pleins de préjugés et de peurs. Trouver une chambre d’hôtel correcte, louer une voiture, faire la route en sécurité … tout est obstacle alors. Des amis d’Alger nous accueillent, nous conseillent, nous tuyautent, – les relations et le système D sont les clés de la réussite – et nous voilà partis tous les deux au volant d’une antique Passat de location au-delà des montagnes, vers le Sud, aimantés par la soif du désert qui animait Isabelle Eberhardt. Première halte : Aïn Sefra où se trouve son tombeau et où nous sommes censés rencontrer un Père Blanc, « fou de notre héroïne », nous a-t-on dit.
J-R H –Bien sûr, nous avons tout lu de ce qu’Isabelle Eberhardt a écrit sur Aïn Sefra. Dans l’une de ses dernières nouvelles, elle a même eu la prémonition d’y être enterrée un jour. Aussi, n’avons-nous nul besoin de carte ni de guide touristique pour nous orienter. Ce séjour recélera certains évènements ou rencontres qu’avec le recul on pourrait qualifier de miraculeux. D’abord, trouver un hôtel au pied des dunes et du Djebel Mekter, propre, au luxe patiné des belles habitations du Sud. Le soir même de notre arrivée, nous montons jusqu’aux ruines de la vieille redoute militaire construite autrefois par Lyautey, et après le coucher de soleil, nous y passons la soirée, réchauffés par les flammes d’un feu de camp, en écoutant les sonorités de la bourgade qui montaient depuis la vallée. Le lendemain matin, je n’ai qu’une hâte : en traversant l’oued, prendre le chemin du cimetière musulman, au pied des dunes où se trouve la tombe d’Isabelle Eberhardt.
Et les rencontres s’enchaînent. De natures différentes, mais toutes significatives. Peut-être avons-nous trouvé l’entrée de la Voie droite ? En montant vers le cimetière, c’est d’abord un magnifique cheval blanc attaché par un licol qui m’impressionne en nous accueillant par son allure fringante. Comment ne pas penser à Souf, le cheval de notre héroïne à El Oued ? Après un bref dialogue avec cet animal posté là comme un gardien de la sépulture, j’accélère le pas vers la prochaine rencontre.
Nous entrons dans le cimetière par une brèche du mur, j’ai le désir enfantin de découvrir la tombe avant Marie-Odile. Les pierres tombales sont rares dans les cimetières musulmans du sud, seul un monticule de terre marque les sépultures. J’aperçois celle d’Isabelle Eberhardt, trois dalles de roche brute érigées comme dernier lit de repos, qui s’intègre à l’espace minéral de sable et de rochers.
« Comme elle est grande… » dit derrière moi Marie-Odile, pendant que je déchiffre l’inscription gravée sur la pierre tombale : « Isabelle Eberhardt, épouse Slimène Ehnni, Mahmoud Saadi[1], morte dans la catastrophe d’Aïn Sefra, le 21 octobre 1904. » C’est peu dire que nous sentons sa présence. Après un moment de recueillement, nous avons très vite l’impression d’être avec une amie. Aussi avons-nous pris nos aises, assis à côté de la tombe. Jusqu’au moment où mon regard est attiré par les couleurs d’un « arc-en-ciel mobile » devant le marabout, au sommet du cimetière, le mausolée du saint patron d’Aïn Sefra, Sidi Boutkhil. Les robes chatoyantes des femmes qui nous ont vus et nous appellent pour que nous allions les rejoindre.
En entrant dans le tombeau de Sidi Boutkhil, j’ai l’impression d’être dans un tableau de Delacroix. Elles sont bien une dizaine, plus ou moins alanguies, tout autour du maqâm[2]. Il faut dire que Sidi Boutkhil a la réputation de rendre fertiles les femmes en mal d’enfant. Moi qui ne l’ai plus fait depuis ma communion solennelle, je salue le saint homme en priant, lui demandant sa protection et de nous ramener sains, saufs et riches de découvertes sur la vie de notre héroïne. Je m’attarde volontiers dans ce tableau orientaliste, essayant de répondre en sabir aux questions curieuses des femmes, mais sur l’insistance de Marie-Odile, je quitte à regret cet endroit béni.
Nous montons la rue en pente du vieux ksar d’Aïn Sefra et nous sommes émus par le geste délicat d’un vieil homme qui pose son bras sur l’épaule d’un gamin. « J’ai très envie d’un thé », dis-je à Marie-Odile, et quand nous arrivons à sa hauteur, l’homme se tourne vers nous et nous propose de boire un thé dans sa maison. Il est fier de nous présenter la jeune femme de vingt ans qu’il vient d’épouser.
La dernière rencontre d’Aïn Sefra n’est pas moins fructueuse. Elle va être le prélude à une grande amitié. Nous n’avons aucune attirance pour les curés, mais celui-là n’est vraiment pas banal. Il a l’air bourru quand il entrouvre sa porte où seule sa barbiche dépasse. « Je n’ai qu’un quart d’heure à vous accorder », nous dit-il. Nous le quitterons quatre heures plus tard, à la nuit tombée. Le père Cominardi vient d’ouvrir pour nous sa malle aux trésors. Un fichier où il a consigné tous les articles et livres parus sur Isabelle Eberhardt depuis sa naissance jusqu’à nos jours. Et ce n’est pas tout : les photos en noir et blanc qu’il a recueillies et agrandies, et quand il en place le tirage sous nos yeux, des larmes affleurent à nos paupières. Elles scellent une relation qui s’achèvera des années plus tard avec la mort de notre ami.
M-O D – L’image jaillit devant nos yeux. Le panorama de l’oasis dont nous avons toujours rêvé. Nous venons de traverser une centaine de kilomètres d’une hamada pierreuse décourageante depuis Béchar. La route s’élève soudain vers un col. Apparaît le ksar de toub ocre de Taghit qui, perché sur un rocher, se détache sur la première dune du Grand Erg Occidental, au-dessus du ruban émeraude du cours d’un oued bordé de palmiers et envahi de lauriers en fleur.
Isabelle Eberhardt n’est jamais venue jusqu’à Taghit ; elle s’est arrêtée au milieu de la piste, à El Moungar, où un convoi militaire venait de tomber dans une embuscade. Des morts et des blessés, et un reportage pour des journaux d’Alger.
Le jeune homme dissimulé derrière un carrousel de cartes postales nous voit arriver de loin. Abderrhamane nous demande si nous avons une montre à vendre. Plus tard nous sommes attablés avec lui au café de l’hôtel de Taghit, le seul à des kilomètres à la ronde. Il est revenu et nous a rendu la montre : « Mon cœur est malade. Entre nous, pas de commerce ». Une amitié toujours vivante dans notre pensée nous permettra une initiation à la vie nomade chez son oncle Hamza, qui parcourait avec son troupeau un espace aussi grand que la région parisienne.
Hamza vient nous chercher avec sa Land Rover réformée de l’armée algérienne et nous suivons la piste jusqu’à l’heure de la prière de l’asr[3]. Arrêt obligatoire. Ils sont trois hommes alignés pour la prière et nous les regardons se prosterner discrètement à l’écart. Ils ont de la chance, pensons-nous, en y voyant comme un hommage à l’entrée du grand désert.
Sous la tente, à des kilomètres de tout lieu habité, Hamza nous lance :
– Et vous, comment faites-vous ? Vous croyez en Dieu ?
La question gênante que nous voulions éviter, en guise de réponse nous nous cachons derrière les mérites du doute. Hamza a l’air affligé et redouble de prévenances à notre égard. Alors nous ajoutons :
– Oui, c’est vrai on doute, mais… on cherche !
– Si vous cherchez, répond Hamza avec un sourire épanoui, vous trouverez.
Ignorants de l’islam, nous ne savons pas encore que nos deux amis appartiennent à une tribu qui est en même temps une grande confrérie soufie du Sahara occidental, les Ouled Sidi Cheikh. Et pour les soufis, seul celui qui cherche est cherché. Nous l’apprendrons bien plus tard dans une phrase des Maqalat de Chams de Tabriz, le miroir de Rûmî : « Ô chercheur sincère, garde ton cœur heureux, car Celui qui réjouit les cœurs est tout à ton entreprise. (…) A l’œuvre, Il est celui qui cherche (tâlib) ou bien Il est celui qui est cherché (matlûb). »
Après plusieurs séjours au campement de Hamza, nos amis nous ont prévenus : « Vous, plus tard, vous serez musulmans ».
J-R H – « C’est vous ! ». On cherchait Momo depuis trois jours et c’est lui qui nous trouve, dans la rue Didouche Mourad, au pied de la Casbah d’Alger. Quand on lui dit qu’on aimerait qu’il nous montre la casbah d’Isabelle Eberhardt, il nous prend chacun par un bras et nous emmène dans sa petite maison, une douira, ancien logement des domestiques des pirates turcs. Un escalier qui monte en colimaçon vers la lumière d’une terrasse et le salon de Momo, où nous nous installons sur un divan, sous le tableau de Dali d’un Christ en croix.
« J’ai écrit un texte pour vous ce matin. » Nous venons de rencontrer notre premier maître spirituel. Momo, Himoud Brahimi, le sage de la Casbah, écrira des textes métaphysiques jusqu’à sa mort en 1997 et fidèlement, il nous enverra par courrier la copie de chacun. C’est ainsi que les mots de Momo à l’oral ou à l’écrit finiront par ouvrir nos cœurs.
La casbah d’Isabelle Eberhardt « où il faut monter chaque marche à coups de reins répétés », il nous la montre si bien qu’on finit par croire qu’elle nous accompagne dans les ruelles, sous les porte-à faux, sur la place où elle s’asseyait au café pour fumer sa pipette de kif. En échange, nous donnerons à lire à Momo « Sables », notre vie romancée d’Isabelle Eberhardt et ses œuvres complètes enfin éditées dans le respect scrupuleux de ses manuscrits. Et il nous dira : « Elle avait le don de voir la présence du divin en chacun ».
M-O D – Bachir chante, sa voix me prend aux tripes. Elle a des accents rauques non dépourvus de douceur. Il est accompagné par « le cercle des poètes » d’El Oued, six ou sept jeunes entre vingt et trente ans qui marquent le rythme sur des bidons de plastique jaune, et un joueur de oud. Nous les avons rencontrés dès notre arrivée alors que nous flânions dans les rues de sable du vieil El Oued. Au « Milkbar », Lazare, le barman, nous demande ce que nous venons faire dans cette région du Souf, au sud-est de l’Algérie.
– Nous sommes sur les traces d’une écrivaine francophone, qui a vécu ici.
– Ah, Elizabeth (sic) Eberhardt, nous répond Lazare à notre grande surprise.
Lazare nous présente Abdel qui a découvert l’existence d’Isabelle Eberhardt et sa vie à El Oued lors d’un séjour à Genève. Il est devenu ami avec des Suisses qui l’ont invité à venir chez eux. Abdel, l’élément fort du groupe écrit des poèmes et cherche auprès des voyageurs de passage une ouverture sur le monde… Leur groupe se passionne pour les écrits d’Isabelle Eberhardt, grâce aux textes rapportés de Suisse par Abdel. C’est une vraie rencontre, elle a fait un pas décisif vers eux, leur montrant la beauté de leur culture, alors qu’ils rêvaient d’Occident.
Ils nous ont donné un premier rendez-vous au sommet d’une dune, qu’ils surnomment « la Romantique », et tout en buvant le thé rituel, nous admirons, comme notre héroïne, le camaïeu des roses, mauves, bleus pâles festonnés d’or du coucher de soleil, qui glissait sur les coupoles et les toits arrondis des maisons, si caractéristiques du Souf. De notre sommet, nous pouvons apercevoir aussi « la Dormeuse », leur autre dune de prédilection, et dans les vallées de sable où se nichent les jardins, les sommets des palmiers, sous lesquels poussent les grenadiers, les abricotiers, et autres amandiers ou figuiers. Dans un jardin proche, plus de quatre-vingts ans auparavant Isabelle a rencontré Slimène. Elle, vêtue en Mahmoud Saadi et lui du burnous rouge de Spahi. Comme nous avons fantasmé sur leur rencontre ! Leur amour dont témoigne leur correspondance, a été l’un des creusets où elle a puisé la saveur spirituelle. Tous deux sont devenus disciples de la Qâdiriyya, fondée par le cheikh Djilânî.
On parle beaucoup avec nos amis de l’existence des confréries soufies à l’époque, à El Oued, et certains découvrent l’engagement spirituel de leurs grands-parents. Ils se mettent pour nous à la recherche de tout ce qui pouvait revenir de ce passé, comme le chapelet en perles de bois brun des Qâdiris. Ce chapelet qu’Isabelle Eberhardt portait parfois autour du cou lors de ses pérégrinations dans le désert et qui souvent lui a servi de viatique. Ce même chapelet que nous égrèneront assidument quelques années plus tard.
Ce soir, nos nouveaux amis nous ont invités à partager un couscous préparé par des sœurs ou des mères. Nous sommes dans le quartier des Hacheche, où ont vécu Isabelle et Slimène, peut-être dans leur ancienne maison, ou en tout cas dans une maison très semblable à la leur : grande cour intérieure autour de laquelle se répartissent les lieux d’habitation, l’écurie, des remises.
Bachir chante avec cœur des chants du sud, le oud soutient sa voix, les rythmes s’accélèrent et me voilà soudain traversée par une évidence fulgurante : Isabelle est là, avec nous, c’est tout juste si je n’aperçois pas un sourire exprimant son plaisir de nous voir réunis chez elle, en son honneur. Et je réalise soudainement que nous sommes le 17 février. Le jour de son anniversaire. Toute l’assistance s’émerveille de ce qui est bien autre chose qu’une simple coïncidence. La voix de Bachir se fait plus profonde encore, nos cœurs battent à l’unisson, notre émotion est palpable et nous rapproche dans une savoureuse communion.
J-R H – La vieille Land Rover de notre ami Hamza est surchargée d’un amas de bagages, de ballots et de baluchons sur lequel se sont perchés trois ou quatre jeunes garçons. La cabine aussi est surpeuplée et nous suivons dans une antique 4L, nouvelle acquisition d’Abderrhamane, qui veut se consacrer au transport. Nous partons pour l’oued Namous, le point de rendez-vous annuel de la tribu des Ouled Sidi Cheikh. Un pèlerinage, une réunion spirituelle où chaque année, avec le dhikr et les invocations, ils célèbrent la mémoire de leur cheikh.
« Vous serez nos invités », avait dit Hamza, et sûrement les seuls Occidentaux. Une unique obligation : être habillé en blanc.
Le campement s’étend sur plusieurs kilomètres dans le lit de l’oued Namous, tentes de nomades, voitures, camions, tout ce qui peut servir d’abri est installé dans un désordre harmonieux. Le centre névralgique en est une grande tente que chaque année les femmes restaurent afin qu’elle serve d’abri aux prières et aux invocations des différents groupes réunis.
La ilâha illa Allâh[4]… Nous qui ignorions ce que pouvait être un dhikr, nous sommes rapidement initiés en écoutant ces invocations répétitives. Pendant les prières, d’autres se livrent à la fête traditionnelle de la fantasia, qu’Isabelle Eberhardt décrit si bien. Après deux jours et trois nuits de bivouac, et d’invitations çà et là à partager le repas de telle ou telle famille, on nous demande de nous placer légèrement à l’écart pendant que tous les hommes présents se réunissent, formant un grand quadrilatère. C’est l’instant de la dernière invocation. Au milieu, un homme petit et vif lance la prière et se met à courir à l’intérieur de ce rectangle et les voix des invoquants le suivent à la trace, comme une vague sonore qui s’enroule derrière lui. Finalement, il s’immobilise au milieu et pour la dernière fois, tous prononcent les paroles sacrées. De notre poste d’observation, fascinés, nous avons l’impression de voir monter dans un nuage impalpable, la prière vers le ciel.
Nous rentrons à Béchar poussés par une belle énergie et là, nous apprenons que l’avion que nous devons prendre tôt le lendemain matin pour rentrer à Alger n’est pas parvenu jusqu’ici à cause d’une tempête de sable. Le seul moyen de ne pas manquer notre correspondance pour Paris est de voyager en voiture toute la nuit. Nos amis se font forts de dénicher un chauffeur fiable et un véhicule acceptable pour cette longue remontée de près de mille kilomètres vers les rives de la Méditerranée.
Le soir n’est pas encore tombé quand nous nous installons sur la banquette arrière d’une robuste Peugeot, un peu inquiets de ce retour hasardeux. Néanmoins, les émotions du pèlerinage et la fatigue aidant, nous ne tardons pas à nous endormir après avoir vérifié que notre chauffeur paraît un guide sûr.
Les chaos de la route cessent. La voiture s’immobilise. J’émerge rapidement du sommeil. Où sommes-nous ? Mon regard à travers la vitre s’arrête sur une silhouette qui couvre toute la porte d’une échoppe qui semble être un café. Il me faut quelques secondes pour réaliser que j’ai juste en face de moi la photo en pied agrandie à taille réelle d’Isabelle Eberhardt en costume saharien. À peine réveillé, face à cette présence, le cerveau accepte cette évidence. Je réalise que nous sommes à Aïn Sefra, face à un café dont le propriétaire a dédié son enseigne à notre héroïne, car il fait partie d’un groupe qui cultive son souvenir.
On s’en doute, cette pause a une saveur bien particulière et toute crainte s’envole : nous arriverons à temps pour monter dans l’avion pour Paris.
M-O D – « Je vous aime, je suis votre ange gardien. » Le verre de cristal retourné sur lequel nous avons posé nos doigts se déplace rapidement d’une lettre à l’autre pour former cette phrase aux mots inespérés et nous plonge dans une sorte de ravissement.
Un petit salon perché au bout d’un escalier en colimaçon, un guéridon d’acajou, deux adolescentes medium récemment initiées par une tante, et l’ami poète qui nous héberge dans sa belle demeure provençale, le moulin de Ventabren. Un chat au dos arqué en accent circonflexe et au poil hérissé regarde fixement quelque chose que nous ne voyons pas.
Les jeunes medium ont insisté, brûlant d’envie de convoquer Isabelle Eberhardt, dont nous leur parlions chaque soir, pour une séance de spiritisme. Ce soir-là, en rentrant des archives d’Outre-Mer à Aix en Provence où nous avions passé la journée immergés dans les manuscrits d’Isabelle Eberhardt, encore enivrés de sa belle écriture, nous n’avons pas réussi à les dissuader.
Curieusement les réponses de l’esprit convoqué sont pertinentes, pleines d’humour, énigmatiques quant à la paternité imprécise de notre héroïne et dénuées de toute faute d’orthographe. Cette déclaration d’amour nous accompagnera tout le long du parcours mené à ses côtés. Après cette étrange rencontre avec ce qui pourrait se nommer l’« esprit d’Isabelle », nous avons pu penser qu’une baraka tout eberhardtienne nous protégeait et nous menait tranquillement vers un total changement de perspective.
J-R H – La lumière. Je l’ai réalisé plus tard en revoyant les images. Quel est le sorcier qui a fait cet éclairage ? Auréolés de lumière, nous irradions sur le plateau de l’émission d’Apostrophes. Elle est centrée sur Edmonde Charles Roux qui, après des années, vient enfin de publier sa biographie d’Isabelle Eberhardt. Et comme nous avons proposé à son éditeur Grasset, de publier aussi pour la première fois ses œuvres complètes enfin conformes à ses manuscrits, Bernard Pivot a compris qu’il serait intéressant de confronter l’œuvre et la biographie. À l’époque, un passage à Apostrophes, pourvu qu’il soit réussi, débouchait forcément sur un succès des ventes. Malgré nos craintes et nos peurs, il faut croire que nous n’avons pas été mauvais. Car pour la première fois les « Écrits sur le sable » d’Isabelle Eberhardt allaient toucher une frange du grand public. Le soir de l’émission nous n’avons pas échappé pas aux mondanités parisiennes, mais ce n’était pas désagréable de côtoyer dans une soirée intime quelques célébrités, comme Isabelle Huppert qui brûlait d’envie d’interpréter le rôle d’Isabelle Eberhardt dans un film d’envergure.
Mais ce n’est pas la mondanité qui nous attire. Nous n’avons qu’une idée : repartir, aller plus loin vers le cœur du grand désert.
Cette fois notre ami Hamza, à l’approche de l’été, a installé son campement au centre d’un cirque de dunes, le creuset même de son clan et de ses ancêtres. Un seul arbre puissant ombrage la margelle d’un puits qui a été creusé par son grand-père. Bons élèves, nous avançons dans notre initiation à la vie nomade et Hamza va nous faire découvrir une nouvelle facette de son talent : c’est un chasseur hors pair. Pendant deux jours nous avons traqué sans remord les jolies gazelles. Les pisteurs sont partis sur leurs traces et dès qu’ils les signalent, la vieille Land Rover d’Hamza bondit à travers les dunes dans un parcours parfois aérien pour arriver à portée de fusil.
Le lendemain, le déjeuner dans la zeriba, une hutte de palmes ajourée, est un délice. Hamza nous fait goûter ses brochettes composées de morceaux de choix. La conversation, toujours émaillée de plaisanteries complices et de rires, devient sérieuse quand Hamza, évoquant le passé, s’adresse à l’un de ses neveux, notre ami Belkacem.
« Tu ne le sais pas, mais le convoi militaire pour Taghit tombé dans une embuscade à El Moungar, c’est ton grand-père qui le guidait. On n’a jamais su s’il les avait emmenés délibérément dans ce piège. »
Le combat d’El Moungar. C’est pour ça qu’Isabelle Eberhardt est venue dans le Sud Oranais en 1903. C’est pour ça qu’elle est devenue l’amie de Lyautey à Aïn Sefra, c’est pour ça aussi qu’elle est partie tout un été comme disciple du cheikh Sidi Ben Brahim, de la confrérie des Zianiya de Kenadsa, à la frontière marocaine.
Et nous, nous avons rencontré Abderrhamane et son cousin Belkacem, établissant un lien subtil avec le passé.
À l’ombre de la zeriba, les mots s’alanguissent puis cessent. Je m’aperçois que mes compagnons s’endorment un à un pour une sieste paisible et Marie-Odile n’est pas la dernière. La réminiscence d’El Moungar qui finalement aboutit à la mort d’Isabelle Eberhardt dans l’inondation d’Aïn Sefra, m’a bouleversé. Je pense à elle, je l’imagine dans ce coin de Sahara, non pas la peau bronzée, mais le visage patiné par les vents et le sable. Je regarde fixement l’espace au-dessus de la porte. Une bande de ciel bleu profond, la couleur palpite dans la lumière. Alors, je sens sa présence, c’était simple, et sans la voir je peux l’appréhender, une présence intime, évidente. La confirmation de tous les signes qui nous sont parvenus avec une belle obstination.
M-O D – Mer de palmiers vue du haut de la falaise, l’immense palmeraie de Figuig est devenue notre jardin. L’oasis saharienne la plus proche de Paris. Isabelle Eberhardt y a été la première Occidentale à y pénétrer en 1903. Les gens de Zénaga s’en souviennent. Elle avait le droit d’être là, au Maroc, car elle était musulmane et comme elle a écrit des choses fortes sur eux et leur histoire, ils lui en sont reconnaissants.
La pleine lune diffuse sa lumière sombre sur l’ancienne demeure du ksar de Loudaghir, l’un des sept ksour de l’oasis. Les voix de deux comédiennes s’élèvent au-dessus du patio où sont installés, nombreux, les habitants. Les mots d’Isabelle Eberhardt résonnent d’une couleur particulière car nous sommes dans les lieux qui les ont faits naître.
L’Institut Français de Oujda a organisé sur notre proposition cette soirée, étape d’une tournée au Maroc. Mais cette soirée s’incruste dans nos mémoires car cette fois Isabelle est là, dans la puissance d’évocation de ses écrits logés depuis longtemps dans nos cœurs.
Quelques jours plus tard nous nous retrouvons attablés autour d’un thé et d’assiettes de miel arrosé d’huile où nous imbibons des morceaux de pain maison. Nous sommes à Madagh, non loin de Berkane, la zaouïa du cheikh Sidi Hamza, mais il est absent ce jour-là. A Paris, au forum Vaugirard, nous avions rencontré un groupe de ses disciples et la lecture des ouvrages de Martin Lings commençait à nous initier au soufisme. Comme par hasard c’est en 2004, l’année du centenaire de la mort d’Isabelle Eberhardt, que nous avons franchi le pas en entrant dans la Qâdiriyya, comme elle l’avait fait bien des années avant à El Oued.
J-R H – Tasawwuf [5]. C’est le titre du dernier texte de Himoud Brahimi, que nous venons de recevoir et il nous a demandé : « Vous savez, cette femme qui travaille au CNRS, Eva de Vitray, j’aimerais que vous lui fassiez lire ce texte. » Pris dans l’agitation parisienne, nous nous sommes empressés d’oublier cette requête, bien que nous connaissions déjà Eva de Vitray par la lecture de « Islam, l’autre visage », où elle raconte son engagement. Deux ans après la mort de Momo en 1997, avec une vague culpabilité, Marie-Odile décide d’appeler son éditeur. Et elle s’entend répondre : « Elle vient de mourir ».
Curieusement, notre défaillance établit un lien entre l’enseignement de Momo et les textes d’Eva de Vitray qui nous sont devenus familiers. C’est elle qui nous a fait connaître Muhammad Iqbal et bien sûr son cher Rûmi. C’est la continuation de ce qui va devenir notre « silsila »[6] à tous deux : Isabelle Eberhardt, Himoud Brahimi, Eva de Vitray et Cheikha Nûr, la Mathnawi Han, celle qui commente le Mathnawi, ouvrage d’initiation de Djalal od Dine Rûmi… Nous envions les gens qui ont entrepris la lecture en commun de l’Évangile autour de la psychanalyste engagée spirituellement, Marie Balmary. Alors, cette idée nous est venue à tous deux : pourquoi pas avec le Mathnawi ? Et pour placer cette démarche sous les meilleurs auspices, nous nous sommes initiés aux cercles de thérapie de l’âme conçus par le Cheikh Bentounès. L’héritage du Cheikh al-‘Alawi et la lecture de Rûmi, pouvait-on trouver meilleur accompagnement ? Et quand Cheikha Nûr a su qu’un groupe lisait le Mathnawi à Paris, elle a manifesté le désir de nous connaître. Istanbul est devenue alors notre destination privilégiée avec cette arrière-pensée : aller plus loin à l’Est, jusqu’à Konya, en pèlerinage au mausolée de Rûmi.
C’est ainsi que, un beau jour enneigé de janvier, nous nous sommes retrouvés avec Cheikha Nûr et ses disciples autour de la tombe d’Eva de Vitray Meyerovitch. Sa dépouille avait été transférée d’un cimetière de la banlieue parisienne jusqu’à l’ombre du mausolée, dont le cône de tuiles vertes est devenu un phare reconnaissable de loin pour ceux qui viennent rendre hommage à leur maître.
Marie-Odile Delacour et Jean René Huleu, anciens journalistes et reporters, notamment à Libération, sont avant tout des spécialistes d’Isabelle Eberhardt à laquelle ils ont consacré une partie de leur vie. Ils ont publié plusieurs ouvrages la concernant : dont Sables, le roman d’Isabelle Eberhardt chez Liana Levi, 1986 ; Un amour d’Algérie aux Éditions Joëlle Losfeld, 1999 ; Le voyage soufi d’Isabelle Eberhardt, Joelle Losfeld, 2008. En outre, ils ont permis la réédition de la totalité de son œuvre foisonnante, qu’ils ont préfacée, sous le titre Écrits sur le sable, aux éditions Grasset, 1990.
Ils sont également à l’origine de la création de l’association Les amis d’Eva Vitray de Meyerovitch, traductrice française de Djelal od-Dîn Rûmi, le grand maitre soufi, et notamment de son œuvre majeure, le Mathnawî. Tous deux en animent d’ailleurs, depuis des années, des cercles de lecture, à la lumière de l’enseignement de Madame Nûr Artiran, spécialiste turque de Rûmi et commentatrice autorisée par les maîtres de la Voie mevlevi.
Nordine Chakri est parti avec son appareil photo sur les traces d’Isabelle Eberhardt, poussé par le souffle nomade. Il y a capté des images subtiles et fugaces, en évitant tous les poncifs. Elles lui ont valu plusieurs expositions et la publication d’un livre Souffle nomade, aux éditions lemessage, Paris, 2018, dont sont extraites trois des photos de cet article.
Conscience Soufie a demandé aux deux auteurs de choisir un passage qui les touche tout particulièrement dans l’œuvre d’Isabelle Eberhardt. Voici donc un extrait de la nouvelle « Les Oulémas » où Isabelle Eberhardt parle d’elle-même au masculin.
L’Ouverture
(…) De tous les maux qui affligent l’âme humaine, le doute est le plus lent et le plus ardu à guérir… Et l’homme qui pense n’est plus maître de croire ou de nier.
Ce fut donc en une grande tristesse, en une angoisse intense que je cherchai la félicité de la Foi.
Or, un soir limpide d’été, quand la grande chaleur lourde du jour se fut apaisée, je passai parmi la foule silencieuse des musulmans, dans la petite ruelle blanche, dans l’ombre du vieux minaret doré d’une vague patine de soleil.
Là-haut, dans la lumière de pourpre et d’or irisé, Hassan le muezzin chantait de sa voix mélancolique aux douces modulations lentes l’éternel cantique du Dieu unique… Cette voix de rêve traduisait d’une manière saisissante toute la grande sérénité de l’islam.
Et soudain, comme touché d’une grâce divine, en une absolue sincérité, je sentis une exaltation sans nom emporter mon âme vers les régions ignorées de l’extase.
(…) Pour la première fois de ma vie j’entrai avec une joie inexpliquée, intense et douce, dans la fraîcheur parfumée de la djemaa emplie peu à peu de bruissements étouffés et de vagues échos…
Pour la première fois, en franchissant ce seuil pourtant familier, je murmurai avec leur foi inébranlable : Allahou Akbar !
En cette heure bénie les doutes étaient morts et oubliés. Je n’étais plus seul en face de la splendeur triste des Mondes…
En un frisson de mystère j’eus, en l’instant précis où se mourait là-haut l’appel triste de Hassan, comme un pressentiment intime d’éternité. Et j’allai, les yeux baignés de larmes extatiques, me prosterner dans la poussière, devant la majesté de l’Éternel. »
Extrait de la nouvelle « Les Oulémas » d’Isabelle Eberhardt, qui parle d’elle-même au masculin.
[1] Mahmoud Saadi est le nom masculin que s’était attribué Isabelle Eberhardt.
[2] Maqâm : lieu de sépulture d’un personnage saint.
[3] Al-‘asr : prière rituelle qui marque la deuxième partie de l’après-midi.
[4] « Pas de divinité hormis Dieu », première partie de l’attestation de foi, premier pilier de l’islam.
[5] En arabe, ce mot signifie « soufisme ».
[6] Silsila, terme soufi qui désigne la chaîne de transmission initiatique, de maître en maître.